
Architecte, mot épicène, désignant une profession où le genre est indistinct. Convoquant les représentations qui en sont faites, l’attribut professionnel est bien souvent masculin et (encore) bien peu féminin. Cependant, les femmes pratiquent et appartiennent à l’architecture depuis la fin du XIXe siècle. Retour avec Stéphanie Bouysse-Mesnage, historienne de l’architecture, sur l’histoire, le rôle et les pratiques des « femmes architectes ».
Chroniques – Quand il est question de l’entrée des femmes en architecture, est évoquée souvent leur visibilité à partir des années 1990-2000. Or, ne sont-elles pas présentes depuis bien plus longtemps que cela ?
Stéphanie Bouysse-Mesnage – L’entrée des femmes dans les cursus d’architecture est concomitante à celui des femmes dans les autres cursus. C’est entre le début des années 1880 et la fin des années 1890 que les femmes entrent à l’École des Beaux-arts ou à l’Ecole Spéciale d’Architecture. Les premières sont souvent étrangères comme Julia Morgan ou encore Laura White, toutes deux Américaines. Déjà diplômées pour certaines dans leur pays, elles viennent parfaire et compléter leurs études, notamment aux Beaux-Arts, école à la réputation internationale. Mais la figure de la « femme architecte » commence à émerger réellement avant la guerre mondiale, puis s’incarne davantage dans l’entre-deux-guerres et dans la période des 30 glorieuses. Il est courant que ces femmes soient issues de milieu proche de l’architecture, où les pères, les frères ou les oncles exercent la profession. Elles grandissent dans un milieu culturel favorable à l’architecture et beaucoup d’entre elles évoquent une véritable vocation pour l’architecture.
De quand date leur inscription à l’Ordre des Architectes ?
Les données manquent un peu mais j’ai pu étudier celles de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France. La première année, en 1942, 16 femmes sont inscrites. Les années suivantes, les effectifs des nouvelles inscrites sont moins importants mais, globalement, entre 1940 et 1970, on observe que 50% de la population féminine diplômée en architecture s’inscrit auprès de cet ordre régional. C’est donc un chiffre relativement important. Et les effectifs des femmes ne cesseront de progresser. Pour les autres régions, on manque quelque peu d’archives et donc de données.

Pourquoi les femmes s’inscrivent-elles à l’Ordre des architectes ?
Elles s’inscrivent pour en partie pour « être prise au sérieux ». Le port du titre étant réglementé, se déclarer « architecte » est un passage obligé. Dans la profession, elles connaissent des difficultés à être visibles. De cette difficulté à être reconnue, le diplôme et l’inscription à l’Ordre leur permettent d’être légitimes, autant vis-à-vis de la profession que de la société française. Le processus de féminisation de la profession, qui s’intensifie dans les années 90 avec des figures comme Odile Decq et Nasrine Seraji, date de la fin des années 1970 – début des années 1980. Des pionnières exerçaient déjà avant. Entre 1940 et 1970, en Ile-de-France, ce sont près de 200 femmes qui sont inscrites à l’ordre et sur les chiffres nationaux, bien que cela soit compliqué d’y avoir accès, j’ai pu trouver 100 autres femmes inscrites. C’est incomplet mais cela montre que les femmes sont présentes et accèdent à la profession depuis longtemps.
A côté des femmes qui s’inscrivent à l’Ordre, il y a aussi celles qui ouvrent d’autres voies. Par exemple, Juliette Billard, qui est admise aux Beaux-Arts en 1913, a été illustratrice, enseignante, décoratrice de cinéma. La diversification des métiers de l’architecture, qui est surtout perceptible à partir des années 80 à la suite de la crise économique, préexiste de manière prégnante chez les femmes architectes depuis le début du XXe siècle.

Quelles contraintes pèsent sur elles dans la profession ?
Les femmes négocient entre vie professionnelle et vie familiale. Il faut se rappeler que les femmes, par exemple, ne peuvent ouvrir un compte en banque que depuis 1965. Avant le tournant des années 65-75, leur statut évolue peu. En travaillant sur les femmes dans le troisième atelier d’Auguste Perret, qui correspond à la période entre 1942 et 1954, on voit qu’elles ont souvent des enfants au cours de leur apprentissage, ce qui allonge leurs études mais retarde aussi leur entrée dans la profession. Dans les tableaux de l’Ordre se trouve parfois l’annotation « mise en congés provisoire ». Il y a une négociation permanente qui leur fait reporter des échéances. Marion Tournon-Branly (1924 – 2016) explique ainsi qu’elle n’aurait pas pu exercer cette profession avec une vie de famille. La vie d’agence lui paraît incompatible avec un mari et des enfants. Pour les femmes architectes qui se sont expatriées, comme Eliane Castelnau au Maroc, les conditions de vie ont pu être facilitées. En déléguant la gestion de la vie domestique à d’autres, elle dit avoir pu exercer plus aisément. Par ailleurs, beaucoup de femmes travaillent avec leur conjoint, avec qui elles sont associées. Le développement d’une activité conjointe leur permet de construire. Cette association entre époux commence dès les années 30, et c’est un modèle qui perdure encore aujourd’hui.
L’inscription à l’Ordre des Architectes permet-il une meilleure insertion des femmes ?
Les critères qui définissent la profession des années 40 jusqu’aux années 70 posent un cadre normatif, un cadre qui laisse de côté notamment les femmes étrangères diplômées. Elles sont seulement autorisées à exercer bien que n’étant pas membres de l’Ordre. Mais ce cadre normatif a aussi permis aux femmes françaises et diplômées de s’inscrire. Auparavant, la profession était organisée par diverses sociétés, La Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement (SADG créée en 1877 – ndlr) ou la Société Centrale des Architectes (SCA créée en 1840 – ndlr), qui fonctionnaient par cooptation, par réseaux de sociabilité, ce qui limitait la présence des femmes en leur sein. Avec la création de critères normatifs, la possibilité d’entrer dans la profession leur est ouverte. Par ailleurs, comme le note la sociologue Nathalie Lapeyre pour une période plus récente, les modes d’exercice des femmes inscrites se rapprochent de ceux des hommes : elles exercent d’abord en libéral (60% en 2000).
Vous évoquez également le manque de modèle pour les femmes architectes …
Oui, si la féminisation n’a cessé de progresser, le constat en écoles d’architecture est qu’il y a encore très peu de femmes notamment pour les cours de projet. Celles-ci sont nombreuses en sociologie, en histoire mais, en projet, elles ne sont que 25%, un taux très faible. Il y a un manque critique de modèles pour que les jeunes générations puissent se projeter. J’ai animé un atelier à l’ENSA Nantes pour la journée du 8 mars et nous avions constaté que beaucoup de jeunes femmes se réorientaient à la fin de leurs études. Elles partent plus facilement vers d’autres professions. En 2018 au Deutsches Architekturmuseum, il y a une exposition extrêmement riche sur les femmes architectes qui interrogeait sur l’absence de modèle, un manque terrible.
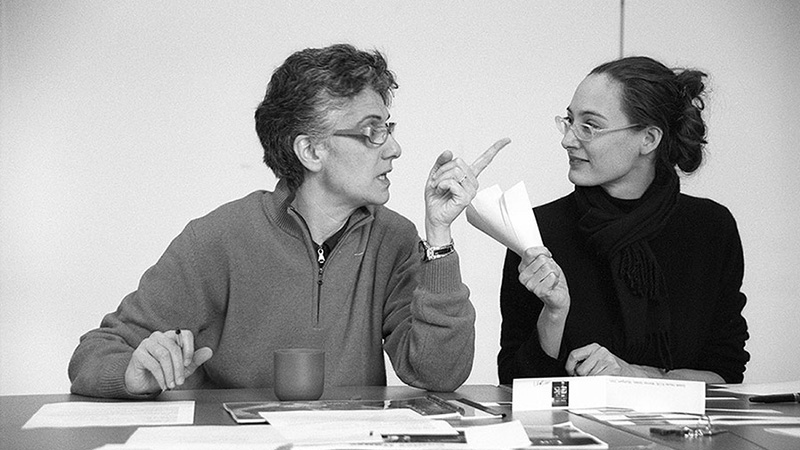

Pourquoi la recherche sur le rôle des femmes en architecture est-elle si difficile à mener ?
Il faut avouer qu’il y a peu d’éléments et peu de recherches sur les femmes en architecture en France. Cela fait un peu moins de vingt ans que ce sujet est travaillé par un petit groupe de chercheuses. Il y a encore beaucoup à faire, les archives et les sources manquent et nous ne disposons que de quelques statistiques très globales. Il faut remonter les parcours de vie pour reconstituer les trajectoires et trouver des archives. Peu de femmes, ne se considérant pas légitimes, ont déposé leurs archives, beaucoup ont été détruites. Quelques fonds sont disponibles à la Cité de l’Architecture mais cela est très marginal. Marion Tournon-Branly, qui était consciente de l’importance du dépôt en ayant eu à le faire pour son père, a donné ses documents aux archives nationales.
Il y a tout de même de plus en plus de recherche sur ces sujets en Europe. Je pense au MoMoWo, projet de recherches soutenu par l’Union Européenne sur les femmes dans les champs de l’architecture, de l’urbanisme, du paysagisme, de l’ingénierie civile et du design, ou à l’édition du Dictionnaire des femmes créatrices également. Des recherches prennent formes, comme celles d’Elise Koering sur les parcours de femmes ensemblières devenues architectes. Cependant, les financements manquent et contraignent parfois à arrêter les recherches. La sociologue Nathalie Lapeyre, qui a travaillé sur la féminisation de la profession au début des années 2000, a interrompu ses recherches pendant vingt ans, faute de financement. Un projet de recherche ANR sur l’histoire de l’enseignement, lui permet actuellement, de les reprendre.
Vous avez évoqué, dans un article de Criticat*, le fait que la HMNOP risque d’éloigner les femmes de la profession. De quelle façon ?
Je n’étudie pas dans le cadre de ma thèse cette période récente mais je suis un peu revenue sur cette idée. La sociologue Elise Macaire, qui a fait un rapport sur ce sujet, montre que les femmes ont tendance à s’inscrire en HMO pour finir leurs études rapidement, tandis que les hommes arrivent avec un projet professionnel plus défini. En fait, on s’aperçoit que dès qu’elles peuvent acquérir de nouvelles compétences, les femmes s’en saisissent. Que cela soit en urbanisme, en construction, dès qu’elles le peuvent, elles complètent leur parcours. Par ailleurs, les différentes réformes, dont la LMD, ont montré que l’architecture peut mener vers différents chemins.
Julie Arnault
Bibliographie indicative :
« Femmes, architecture et paysage », Livraison d’Histoire de l’Architecture, n.35, 2018.
Stéphanie Mesnage, « « Eloge de l’ombre », Criticat, n°10, 2012.
Stéphanie Bouysse-Mesnage, « Trajectoires professionnelles des étudiantes du troisième atelier Perret (École des beaux-arts, 1942-1954) », HEnsA20, novembre 2019, n.7.
Béatrice Didier, Antoinette Fouque, et Mireille Calle-Gruber (sous la direction de), Le dictionnaire universel des créatrices, Paris, Editions des femmes, 2013, 3 volumes.
Nathalie Lapeyre, « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la quotidienneté », Empan, n.53, 2004/1.
Elise Macaire et Minna Nordström (dirs.), GÉNÉRATION HMONP. La formation à l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre comme fabrique de l’architecte, Rapport final, mai 2021.