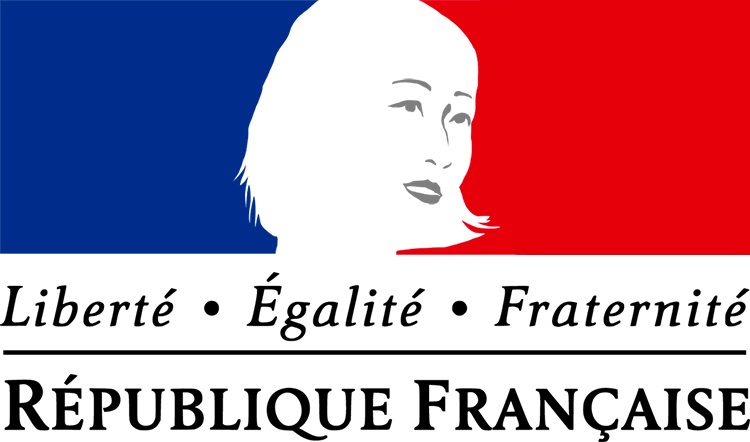
«Là où nous avons été le plus innovant, c’est sur l’architecture en libérant la création architecturale de la logique des normes qui l’étouffe trop souvent – notamment à destination de l’Etat et des collectivités territoriales – et en incitant à un plus grand recours aux architectes», expliquait Patrick Bloche, député des Hauts-de-Seine et rapporteur du projet de loi relative à la création artistique, à l’architecture et au patrimoine.** Que reste-il des intentions de Fleur Pellerin ?
Constatons tout d’abord que cette loi ‘Liberté de Création, Architecture et Patrimoine’ (LCAP) ne porte pas le nom de la ministre qui l’a conçue, phénomène rare en politique française. Etonnant non ? Il faut dire que Fleur Pellerin s’est fait dégager sans ménagement du gouvernement Valls alors qu’elle était peut-être celle qui avait le moins à se reprocher – d’ailleurs elle n’a ni écrit un livre ni fait acte de candidature à la primaire. Du coup, la loi Pellerin est devenue la loi LCAP – pour la rime en CAP, essayer scalp. C’est d’ailleurs dans l’indifférence générale que sa loi a été publiée, en plein juillet, le 16.
Pourtant, l’année auparavant, lors de la première lecture du projet de loi, le ban et l’arrière-ban des instances représentatives de la profession s’étaient emballés et saluaient, «dans un communiqué commun», les premières mesures de son texte. Ha, le «permis de faire» faisait rêver, souvenez-vous. Dont acte.
Aujourd’hui, ce que retiennent surtout les observateurs de la loi du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l’architecture et au patrimoine tient finalement à peu de chose : l’abaissement du seuil du recours à l’architecte à 150 m², qui n’est rien d’autre qu’un simple retour au statu quo ante et n’aura d’influence que marginale, et l’obligation d’afficher le nom de l’architecte sur l’une des façades extérieures de l’ouvrage.
La mesure phare de la loi est peut-être le recours à l’architecte dans le permis d’aménager mais, même si elle fait grincer des dents, son impact est au fond également assez limité tant le fait est que nombre d’élus, de promoteurs et de développeurs ont déjà pris la mesure d’un besoin d’architecture et d’urbanité à la périphérie des grandes villes et dans les secteurs périurbains. De fait, même les centres commerciaux se targuent aujourd’hui d’architecture.
Cependant, un détail de la loi LCAP est passé inaperçu. Relevé par Didier Frochot*, il s’agit d’un amendement introduit par un député lors du premier examen du projet de loi à l’Assemblée nationale visant à protéger la création artistique sur internet. La disposition n’ayant pas été écartée par le Sénat, elle fut entérinée dans le texte du 7 juillet. En substance, la loi impose désormais de nouvelles obligations pour la cession de droits d’auteur, notamment que «les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit». Plus de contrat verbal ou tacite donc.
Ce type de contrat existe déjà, chez les photographes notamment. Désormais, chaque journaliste se doit de faire signer un contrat de cession de droits d’auteur pour chacune des personnes avec lesquelles il converse puisque, désormais, la moindre citation ressort du droit d’auteur. Quand on voit ce qui s’est passé à Bordeaux avec X-TU et les droits d’auteur de la Cité du vin, vous imaginez le bazar. Après les crânes d’œuf du ministère de la Culture, et toute l’intelligentsia avec eux, de se plaindre de la judiciarisation de la société. Mais qui, en l’occurrence, la judiciarise, la société ? Bref, désormais, comme le précise Didier Frochot, «… tout ce qui sort de la bouche de quelqu’un, même improvisé, est protégé par le droit d’auteur. Et cet écrit devra être formulé selon les conditions de validité de l’article L.131-3 précité…» Faites gaffe à la façon dont vous parlez à vos enfants.
Une dernière bouchée de paperasse (et la paperasse électronique est tout aussi casse-pieds) pour la route. Didier Frochot note en effet que la même obligation, par exemple entre une revue et ses auteurs occasionnels, fussent-ils bénévoles, est renforcée.
Avant la loi du 7 juillet dernier, il fallait déjà absolument un accord écrit valide. Comme désormais «la cession globale des œuvres futures est nulle» (article L.131-1), il n’est plus possible de faire signer un écrit à l’avance et une fois pour toutes ; il faudra désormais un contrat pour chaque article ou chaque tribune ou chaque texte ! Ceci pour info pour tous les éditeurs, les agences de communication, les mairies, les publicitaires et les agences d’architecture et tous ceux qui font appel au texte. Dans une société du verbe et de l’écrit, cela ne va pas être facile.
Pour la notice architecturale rédigée par le chef de projet, il faudra désormais le document attestant de sa cession de droits d’auteur de ce texte, au moins son autorisation. A chaque fois, pour tous ! «Chef, voici ma proposition de texte pour le projet Michu». «Super ! Les droits d’auteur, c’est réglé ?» «Oui chef». «Cool !».
Bref, voilà pour le «permis de faire».
Revenons-en à l’inscription désormais obligatoire du nom de l’architecte et de la date d’achèvement de l’ouvrage sur une façade extérieure de son bâtiment, dont se réjouissent le ban et l’arrière-ban des instances représentatives de la profession. Si cette disposition semble en apparence rendre grâce aux architectes, il faut raison garder : chaque bâtiment n’est pas un chef-d’œuvre.
A noter que les promoteurs, quant à eux, ne sont pas tenus d’apposer leur signature mais ils le peuvent, s’ils le souhaitent. Pour les archi, c’est désormais obligatoire. La plaque est d’ailleurs aux frais du maître d’ouvrage et il vaut mieux que ça se passe bien entre le client et l’architecte si ce dernier ne veut pas se retrouver avec une plaque toute pourrie dans un recoin aveugle ou pissent les clochards. L’architecte, précise la loi, «pourra toutefois lui proposer une plaque de son choix».
Même la date d’achèvement obligatoire peut se révéler rédhibitoire tant il y a des immeubles qui vieillissent mal, rapidement. «Maman pourquoi il est tout moche ce bâtiment ?» «Parce qu’il est vieux mon fils». «Chic, Maman, maman, allons voir sa date d’achèvement». «Ha bah non, il a été construit il y a deux ans. Tu vois mon fils, comme quoi» ! «Et c’est qui l’architecte ? Pas Jean Nouvel quand même ?».
Comme quoi, cette obligation peut justement avoir des vertus. Prenez le cas d’un architecte qui travaille jusqu’au permis de construire, laissant la maîtrise d’œuvre d’exécution à d’autres. Ne risque-t-il pas de l’avoir mauvaise quand ses amis et parents verront son nom en GROS sur ce bâtiment, juste à l’entrée, comme ça, quand les gens qui l’occupent se plaindront d’un bâtiment mal construit, c’est à lui, l’architecte, qu’ils penseront. Considérant ses nouveaux droits d’auteur, cet architecte ferait bien de se méfier.
Si par contre le bâtiment est réussi et objet de louanges, comme nombreux sont ceux qui volent au secours de la victoire, il y aura du monde sur la plaque et l’architecte en effet devra peut-être jouer des coudes. Encore que… La loi a en effet prévu qu’en cas d’œuvre plurielle, «le nom de tous les architectes ayant contribué à l’élaboration du projet architectural devra être affiché». Y compris ceux qui ont travaillé à l’agence ? Bref, considérant la dimension des égos d’architecte et le nombre considérable «d’œuvres plurielles», certaines plaques vont prendre de la place.
Pour finir, puisqu’il était question de Fleur Pellerin, notons que, sous son quinquennat, François Hollande aura connu trois ministres de la Culture, et donc ministres de l’architecture, cet art qui s’inscrit dans le temps long. Trois femmes d’ailleurs, Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin et Audrey Azoulay. Trois ministres successifs pour le même poste en trois ans à peine (Audrey Azouley prend ses fonctions en février 2016), si c’était dans le foot que le président changeait trois fois d’entraîneur sur une si courte période, certainement que les fans seraient inquiets.
Cela écrit, même s’il en reste moins qu’espéré dans la loi-qui-ne-porte-pas-son-nom, pour ce qui est d’architecture, au moins Fleur Pellerin aura essayé.
Christophe Leray