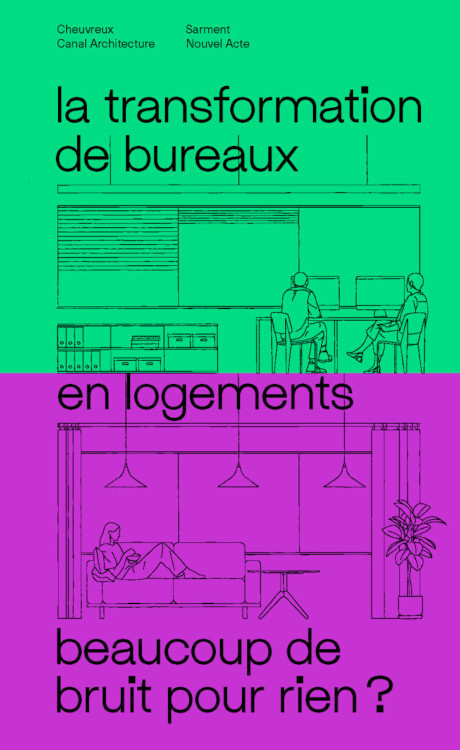Il est aujourd’hui question d’équilibre social, de mutation urbaine, de défi politique. L’architecte accompagne, comme tous les acteurs du secteur, le sujet brûlant de la pénurie de logements. Son rôle est de proposer des alternatives comme des reconversions d’usages, notamment en matière d’habitat, dans le domaine partiellement sinistré du tertiaire. Tribune.
Engager la transformation de l’impressionnant stock de bureaux désertés dépend de la mise en place de nouveaux dispositifs de gouvernance, plus orientés vers les filières industrielles que sur les rénovations traditionnelles réalisées tout corps d’état confondus.
On évoque, en 2030, 12 millions de m² de friches tertiaires obsolètes sur l’hexagone. Au regard de l’histoire nous serions tentés de faire un lien avec la création, en 1944, du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme initié après-guerre pour faire face à la réédification des deux millions d’habitats détruits sur le territoire. Hors infrastructure, 120 millions de m² devaient alors être reconstruits. Dans moins de cinq ans, la présence de 12 millions de m² de bureaux hors d’usage représentera, en comparaison, 10 % de délaissés, chiffre sans précédent. La surproduction du tertiaire sur ces 40 dernières années autorise à dénoncer l’ampleur d’une crise majeure.
Alors bientôt un Secrétariat d’Etat de la transformation ? Ce sujet n’est plus marginal il devient central. Quelles pistes pour y remédier ?
Autorisons-nous à reprendre le terme de massification, mot emprunté au rapport remis à l’État, par André Yché qui évoquait, en 2024, « l’émergence d’une industrie de la transformation des actifs immobiliers ». Le rapprochement avec les filières industrielles invite à favoriser une politique d’équipements préfabriqués hors site, réalisés en ateliers sur l’ensemble du territoire. Concevoir des composants intérieurs destinés à être substitués aux agencements obsolètes des bureaux pour garantir, sur une échelle de temps réduite, la fabrication d’habitats (très) convenables en réponse aux promesses sociales retardées.
Dans le livre « Transformation de bureaux en logements… beaucoup de bruit pour rien ? »,* présenté à l’occasion du MIPIM en mai 2025, nous déclinions au moins trois sujets sur le thème architectural, illustrant les défis à relever sur les cinq prochaines années.
1- La TRANSFORMATION des immeuble existants ne peut pas représenter un coût plus élevé que la construction neuve.
Il faut réviser nos méthodes d’appréciation des projets de conversion de bureaux. La structure pérenne d’un immeuble garantit déjà, par sa présence, 30 % d’un budget construction, « le solide ». Comment se fait-il alors que les coûts travaux d’une opération de transformation soient estimés, lors des appels d’offre d’entreprises, à + 20 % de l’objectif de la construction neuve : 2 700 €HT/m² face à 2 200 €HT/m² ? La provision pour précaution ou aléas n’explique pas la différence.
Pour y remédier et se rapprocher du coût de construction d’une opération neuve, il est indispensable d’établir des analyses documentées et solides afin de préciser les données d’études techniques et financières aux investisseurs. À l’atelier Canal, nous développons des solutions en distinguant trois séquences après productions de diagnostics étendus et confortés dont les résultats influent très tôt sur
les programmations techniques et financières des opérateurs : Réparation à bas coût, Conversion agile, Préfabrication industrialisée.
2- Les INSTITUTIONS disposent désormais de leviers pour agir.
Les préoccupations de Valérie Létard, précédente ministre chargée du Logement, ont déjà fait réagir de nombreux acteurs de l’immobilier, Deux rapports éclairés sur la transformation des bureaux en logements ont été diffusés au début du mois de septembre 2025. On remarque que le scepticisme ambiant en matière de transformation, est en léger déclin.**
La loi DAUBIE,*** publiée le 16 juin 2025, confirme des avancées réglementaires en facilitant les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires aux opérations de transformation. Ce texte, dont les décrets sont attendus, confirme les expérimentations de 2018 en étendant le sujet au-delà des bureaux, en intégrant d’autres actifs à réaffecter au logement.
Déjà, en septembre 2018, la loi ELAN**** engageait la possibilité de déposer un permis de construire « sans affectation », les directives du Permis d’Innover, inscrites dans la loi ELAN, favorisent les dérogations pour atteindre des alternatives aux règles d’urbanisme.
À Bordeaux, un premier démonstrateur national dont le permis de construire, associé à trois dérogations, a été obtenu en mai 2023, relève de cette expérimentation. L’immeuble « sans destination » ou encore, à « double usages », sera mis en chantier sur le site d’Euratlantique cette prochaine année 2026. Dans le cadre de transformations de bâtiments existants, désaffectés ou hors d’usage, un même protocole dérogatoire peut être envisagé.
L’ensemble de ces initiatives institutionnelles va dans le sens des postures partagées pour (sauf exception) ne plus détruire ce qui être métamorphosé. Aussi, faut-il dessiner la boite à outils adaptée à la grande échelle d’un défi national.
3- MASSIFICATION : aller vite, réduire les coûts et les délais.
Ingénierie et architecture sont associées en partenariat avec les aménageurs, les opérateurs et les constructeurs du BTP, afin de mettre en place les outils de l’industrialisation à grande échelle et réviser quelques certitudes grippées sur le couple « coûts et délais ». Les exemples de préfabrication des années 1950/60 viennent à l’esprit. Ils sont requestionnés sous le prisme d’intentions vertueuses, de préoccupations environnementales, d’économies à l’équilibre.
Massifier, dans l’acte de transformer, ne s’assimile plus aux démonstrations des Trente Glorieuses du XXe siècle qui portaient haut les procédés de préfabrication en béton pour gagner en productivité. Les dispositions préfabriquées se déplacent désormais comme de grands meubles autosuffisants, dans le corps même des squelettes en béton, à l’intérieur des structures conservées. Composants légers, mobiles, flexibles, produits en série, aisément manipulables ces techniques orientent déjà les filières professionnelles correspondant à cet élan de massification.
En parallèle, les questions relatives à l’économie énergétique, à la domesticité, aux usages dédiés aux habitants, sont aujourd’hui fortement interrogées. Les typologies intérieures sont revisitées en suivant les souhaits alternatifs des générations montantes, les outils du design sont convoqués pour initier de nouveaux équipements fabriqués industriellement, fondés sur une approche standardisée possiblement ludique.
Ce nouveau paradigme de l’intérieur, tirant bénéfice de la permanence du bâti existant, s’impose aujourd’hui en termes de coûts et de délais, comme une alternative positive à l’exercice des réhabilitations lourdes, n’ayant de lourd que le poids du carbone dépensé.
Moins détruire, transformer en priorité, sous condition d’initier simultanément les dispositifs d’un écosystème pour initier, enseigner et produire à grande échelle.
Patrick Rubin
Canal architecture
Novembre 2025
*Œuvre collective, « La transformation de bureaux en logements, beaucoup de bruit pour rien ? » propose un éclairage de professionnels représentatifs de toute la chaîne de la fabrique de la ville, selon une approche non partisane pour répondre aux enjeux et défis de la création de logements dans le Grand Paris. (Cheuvreux, Canal architecture, Sarment, Nouvel acte, mai 2025, auto-édition)
** Rapports consultables en ligne : Transformation des bureaux en logements : deux rapports remis à la ministre du Logement
*** LOI n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
**** Loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (Elan)