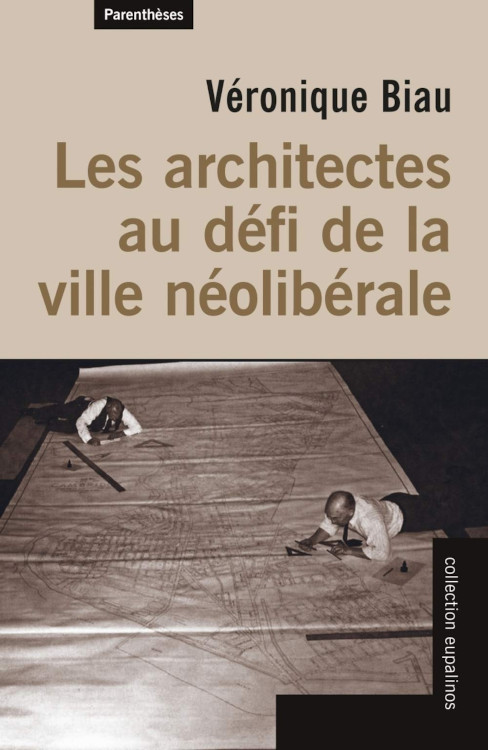Voilà un livre au titre prometteur : les architectes au défi de la ville néolibérale*. Ecrit par Véronique Biau, architecte-urbaniste en chef de l’État et HdR en urbanisme, chercheuse à l’ENSA Paris-La Villette, au Let-Lavue, l’ouvrage offre à ceux qui s’intéressent à l’architecture un état des lieux doublé d’une observation fine des pratiques et d’un regard optimiste sur la profession. Rencontre**.
Chroniques – Vous avez observé pendant trente ans les évolutions de la profession. Quelles sont les grandes étapes que l’on peut retracer depuis les années 80 ?
Véronique Biau -Trois grandes périodes peuvent être distinguées. La première période, dans les années 70-80, est une période d’organisation de la profession marquée par la loi de 1977 et la loi MOP, laquelle va définir les notions fondatrices de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Pendant ces décennies, c’est le cadre réglementaire des marchés publics qui fait référence aussi dans la commande privée.
La seconde période, dans les années 80-90, correspond à celle des grands concours publics d’architecture, notamment avec les grands travaux de François Mitterrand puis les politiques architecturales de prestige de certaines villes, après la décentralisation. C’est le moment où se forge une nouvelle image médiatique de la profession, l’architecte-artiste, à laquelle va s’intéresser un nouveau public d’amateurs.
La dernière période débute à l’orée des années 2000 avec un double avènement, celui de l’introduction de la notion de « développement durable » et l’entrée de plain-pied dans la politique néolibérale avec la financiarisation de l’immobilier et la montée en puissance des majors du BTP qui gèrent la production depuis la question foncière jusqu’à la gestion et aux services. Les partenariats public-privé (PPP) sont un tournant significatif. L’architecte tend à devenir un sous-traitant des grandes entreprises. Alors que la profession se situait historiquement aux côtés des tenants du pouvoir politique, elle passe assez brutalement dans un monde régit par des logiques technico-économiques, des objectifs quantitatifs, la concurrence et le tout-négocié. Or, la plupart des architectes n’ont pas les armes pour ce changement et peu d’intérêt pour ces questions.
Comment réagissent-ils face à l’irruption de ces nouveaux commanditaires ?
Les architectes prennent conscience de la diminution constante de la commande publique et se réorientent vers des marchés qu’ils avaient jusque-là peu abordés : la promotion privée, la maison individuelle, la réhabilitation, l’intervention dans les territoires péri-urbains et ruraux. Ils reconsidèrent la notion de « qualité architecturale » en laissant davantage de place à la sobriété carbone et aux attentes des usagers.
Dans les dispositifs participatifs, les architectes sont sortis de leur position d’artiste. Ils sont entrés en contact avec des groupes d’habitants, des acteurs socio-culturels, des élus locaux. Ils ont évolué quant à la prise en compte du réel.
Les architectes se plaignent fréquemment de leur condition d’exercice mais le portrait que vous brossez est plutôt optimiste ?
En effet, en regardant ce qui se passe actuellement, notamment depuis l’introduction en 2005 de l’HMONP, on voit combien les préoccupations des jeunes architectes ont changé et leurs pratiques aussi. Les nouvelles générations s’écartent du statut de l’auteur, préoccupé de son œuvre. Cette nouvelle génération, où les femmes sont nombreuses, prend parfois des chemins novateurs, avec un intérêt pour le concret. Je vois de jeunes architectes se former à l’ébénisterie, à la charpente, à la terre crue, etc. Et puis il y a l’ouverture à l’international, notamment avec les expériences en Erasmus.
La pratique individuelle évolue aussi vers une pratique plus collective, plus interdisciplinaire, soucieuse de la complémentarité des compétences. La « génération HMONP » se pose des questions nouvelles. Elle s’intéresse moins à sa notoriété médiatique qu’à répondre avec pertinence à la question du logement notamment. On sort de l’objet, du discours doctrinal pour se confronter à la société. Des architectes comme Patrick Bouchain y ont beaucoup contribué, en questionnant les pratiques, en mettant en place des processus alternatifs. Les jeunes générations ont aussi des questions plus pratiques sur la gestion de l’agence comme une entreprise au quotidien : les contrats, le personnel, les archives, etc. Alors que dans les années 80-90, il était accepté que les architectes soient « dans les nuages », les années 2000ont exigé d’eux d’être plus pragmatiques face au risque économique.
Ils restent les spécialistes du projet et il ne s’agit pas pour eux d’abandonner leur posture créative. Mais de la rendre compatible avec les attentes économiques et sociales. C’est un enrichissement de leur apport, pas une marginalisation. A condition qu’ils acceptent de jouer le jeu !
Vous évoquez, ce qui peut paraître étrange car cela pourrait paraître inhérent à la profession, une découverte par celle-ci de la responsabilité sociale ?
Oui, l’architecte s’est longtemps attribué la responsabilité d’agir sur la société mais pour la transformer, inventer un nouveau rapport à l’espace habité, à la ville, … parfois à la limite de l’utopie. Aujourd’hui avec la transition environnementale, la responsabilité sociale devient partagée et il y a une grande attention des architectes pour les usages, pour les ressources naturelles, pour les dynamiques locales. Un travail très intéressant se fait pour des petites collectivités et des communes périurbaines dont les services techniques, peu dotés et peu formés, ont besoin de conseil et d’assistance. Je pense notamment à Bernard Quirot qui, après une carrière dans la grande commande publique, est revenu sur son lieu d’origine pour y conduire un travail tout en finesse et dans le respect de l’identité de ce territoire. L’architecte se réinvente, avec un travail en système D, peu de moyens mais beaucoup d’inventivité.
Et demain ?
La crise sanitaire a conduit à une critique du néolibéralisme : la mondialisation, la primauté de la concurrence sur la solidarité, les critères de la gestion financière ont montré leurs défauts. Il est trop tôt pour annoncer la fin de ce mode d’organisation de nos sociétés. Des intellectuel(le)s comme Barbara Stiegler se questionnent à ce sujet. Mais cela donne envie de se pencher sur les pratiques architecturales qui se posent en alternative ou se nichent dans les creux, là où les préceptes du néolibéralisme ne fonctionnent pas : les territoires ruraux, les villes en décroissance. Ce sont des situations de projet dans lesquelles nous allons devoir inventer, proposer de nouveaux modes de faire. Le chemin est déjà là, les architectes ont commencé à l’ouvrir.
Propos recueillis par Julie Arnault
* Véronique Biau, Les architectes au défi de la ville néolibérale, Marseille, Editions Parenthèses, coll. « Eupalinos », 2020, 246p.
** La librairie Le Genre Urbain organise un débat avec Véronique Biau le 29 septembre 2020.