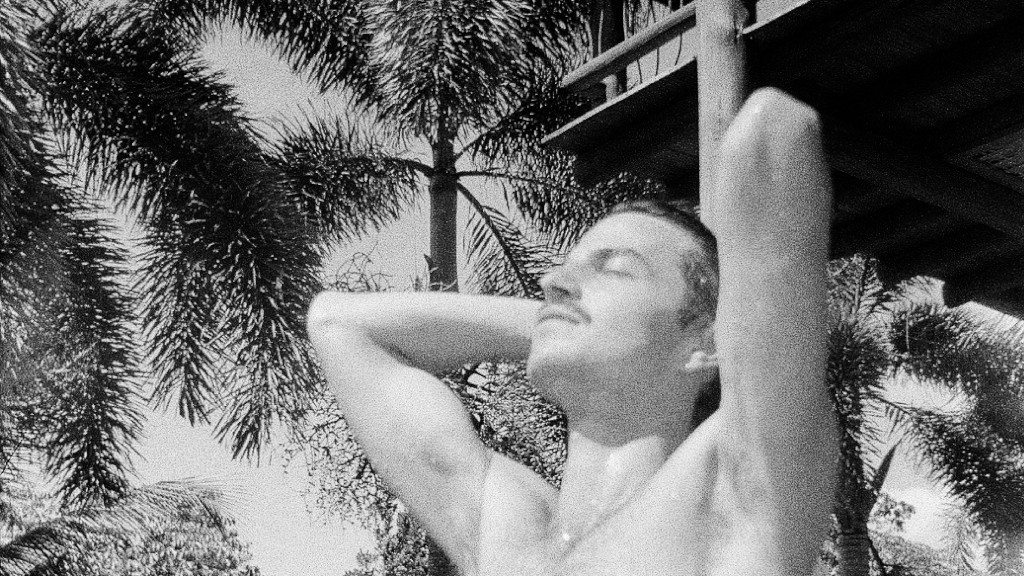
Avant l’été, dans une gare, attrapant un café, mon regard s’est arrêté au comptoir d’un buraliste : Le désir, une philosophie, de Frédéric Lenoir. Quelques semaines plus tard, en vacances, je l’ai ouvert. Et très vite, il m’a ramenée à l’architecture.
Jeune architecte, je me suis lancée sans trop me poser la question : désir de faire, désir d’être libre, désir d’expérimenter. Vite, vite. Aujourd’hui, à un moment de bascule, je me demande : qu’est-ce que je désire vraiment en architecture ? Et comment orienter ce désir pour qu’il me mène non seulement à construire, mais à construire juste ?
La nature du désir : moteur vital et soif insatiable
Les philosophes de l’Antiquité définissaient le désir comme « la visée d’un bien », une sorte d’appétit. Spinoza en faisait la puissance même de la vie, notre moteur vital.
En architecture, je crois que c’est exactement cela : sans désir, pas de projet. Chaque plan, chaque maquette, chaque esquisse est nourrie par un manque, par une aspiration. Manque de lumière, manque d’espace, manque de beauté. Ou manque plus intime : le besoin de laisser une trace, de transformer un fragment de monde.
Je me souviens encore de ce premier marché public remporté. Au début, nous ne comprenions rien aux règles, aux plateformes qui plantaient, aux délais absurdes. Nous essuyions refus sur refus. Pourtant, quelque chose nous tenait debout : Aaaarhh, on l’aura ! Cette obstination n’était rien d’autre que du désir. Quand enfin le marché est arrivé, quelle euphorie ! Mais, très vite, déjà, le désir glissait ailleurs, vers le projet suivant.
C’est là que Frédéric Lenoir appuie en citant le chercheur Sébastien Bohler : notre cerveau, par le striatum, est configuré pour ne jamais être rassasié. À peine un désir comblé, un autre surgit. C’est épuisant, parfois. C’est aussi vertueux : cette soif insatiable nous pousse à apprendre, à évoluer, à chercher encore.
Alors, faut-il se méfier du désir, ou l’accepter comme ce moteur qui nous propulse ? Je crois qu’en architecture, il faut apprendre à le reconnaître pour ce qu’il est : une énergie brute, parfois dévorante, mais indispensable.
Les formes du désir : mimétisme et convoitise
L’historien, théologien et philosophe René Girard a montré que le désir n’est jamais totalement autonome. Nous désirons ce que désirent les autres, ou ce qu’ils possèdent. C’est le « désir mimétique ».
Dans le milieu de l’architecture, cette vérité est visible également. Nous évoluons parfois en cercles, en familles de pratiques. J’ai vu des groupes entiers se tourner vers l’architecture « sociale », d’autres vers les concours de logements collectifs. L’un fait école, attire son entourage, et ainsi se forment des dynamiques de désir partagés, parfois féconds, parfois un peu grégaires.
Moi-même, je l’avoue, j’ai souvent ressenti cette envie, parfois cette frustration, en voyant d’autres à un moment remporter concours après concours. Quand ce n’est pas notre période, on a envie d’être à leur place, d’avoir cette reconnaissance. Puis, en y réfléchissant, je me rendais compte que ces programmes n’étaient même pas ceux que je poursuivais. Alors pourquoi me comparer ? Parce que je suis humaine, tout simplement. Mais le vrai travail est de ne pas se perdre dans ce désir d’imitation, de revenir à soi.
Je me souviens d’une classe d’étudiants libanais que j’ai rencontrée. Ils rêvaient tous de ressembler aux mêmes stars de l’architecture, parce que c’étaient les seuls noms célèbres qu’ils connaissaient et que la renommée leur donne envie. Personne ne voulait ressembler au bon architecte de quartier, y compris celui qui, à côté de moi, dessinait des maisons de soins, modestes mais habitées. La communication de notre métier n’est-elle pas coupable, parfois, d’appauvrir la diversité des désirs, en projetant toujours les mêmes modèles ?
Désirer comme les autres, c’est risquer de courir après un mirage. L’architecture a besoin de désirs multiples, d’ambitions divergentes. C’est cette diversité qui fait sa richesse, pas la répétition d’un même modèle starifié.
Orienter le désir : sobriété et ambition fertile
Que faire de cette énergie ? Les stoïciens invitaient à supprimer le désir, les bouddhistes à le modérer, les religions à le contraindre. Mais Lenoir, s’appuyant sur Spinoza, propose une autre voie : éduquer le désir. Non pas l’étouffer, mais l’orienter.
Je crois qu’en architecture, cette leçon est précieuse. Éduquer le désir, c’est apprendre à hiérarchiser, à distinguer ce qui est essentiel. C’est accepter que l’architecte ne peut pas tout faire, tout avoir, mais qu’il peut viser juste.
Cela ressemble à un projet bien mené : une esquisse pleine de rêves, puis des arbitrages, des coupes budgétaires, des compromis. Tant que le désir reste clair, alors la construction garde son sens.
Il ne s’agit pas d’opposer sobriété et ambition. La sobriété est une méthode, l’ambition demeure nécessaire. Sans elle, pas de transformation, pas d’audace. Une ambition raisonnée, fertile, peut construire des architectures fines et justes, qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui sans renoncer à l’élan créateur.
Conclusion : un désir d’architecture
Aujourd’hui, je me retrouve dans une phase où mon désir d’architecture est plus intense que jamais, plus calme aussi. J’ai envie de prendre le temps. Transmettre, concevoir, bâtir : c’est simple, mais c’est mon essentiel.
Je dis oui à tous les désirs, à toutes les envies de construire, et même de reconnaissances si elles sont justes. Chacun a sa trajectoire. La mienne, aujourd’hui, est de recentrer.
Spinoza disait que le désir est notre puissance d’agir, notre élan créateur. Alors oui, je veux continuer à vivre, désirer, mais avec la pensée. Et j’espère qu’en cultivant ce désir orienté, patient, il sera toujours possible d’assouvir mon envie d’architecture.
Estelle Poisson
Architecte tout court
Retrouvez tous les chapitres du Journal d’une jeune architecte