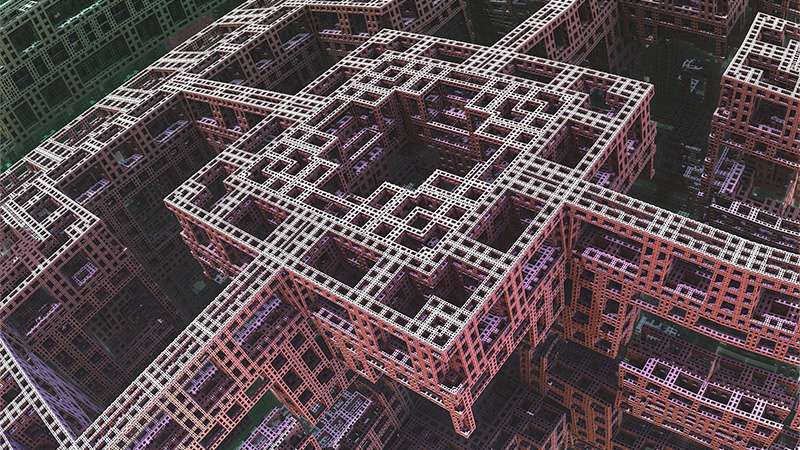
Pour être architecte, il faut avoir une utopie, une manière de faire rêver, avant d’être confronté à la réalité, celle du contexte. Que pensez-vous de la ville du Quart d’heure ? Que pensez-vous de Line city ? Et de la ville flottante ? … Cette question m’a été posée par un critique réputé qui ajoutait : Et vous, quelle est votre utopie ?
Le progrès technique est devenu l’outil d’une modernité qui court après son ombre, qui espère tout de l’innovation. L’architecture, et elle n’est pas seule en cause, n’a plus de goût, plus d’odeur, elle est en quête de sens, une porte grande ouverte au cynisme.
En guise de nouveauté, de pseudo concept, fleurissent la forêt urbaine et la ville dans lesquelles nous n’aurons plus besoin de sortir de chez nous, plus de crainte d’attraper un virus. Le sens de la ville, le sens social de l’humanité est oublié.
L’utopie est l’exact contraire de ce que peut être une démarche de progrès construite avec une volonté, celle d’apporter une réponse concrète aux sujets contemporains : la ville, le logement, la vie en société. L’architecture commence avec la construction d’une idée. J’utilise la notion de construction volontairement, il n‘y a pas d’immanence. Il y a une magie nécessaire, une place pour l’épiphanie, un enchantement dans une logique d’exposition, pas dans la réalité d’une conception qui doit rester contextuelle.
La profusion actuelle des images introduit le trouble. La figuration artistique ou hyperréaliste reste une figuration et il n’y a rien de plus dangereux que la confusion trop souvent réductrice. Le dessin doit être sous-tendu par une idée, une vision. La réalité est complexe, inépuisable, c’est elle qui doit servir de guide. Une smart city désincarnée qui se réduit à des réseaux, des signaux, et qui ambitionne le statut de ville du futur, n’a de ville que le nom. Le mythe a la vie dure, il permet à l’image ou au dessin de faire illusion. Nous y voilà, l’ersatz fait l’illusion.

L’Ecole des Beaux-Arts a été discréditée car elle attachait trop d’importance aux dessins de Giovanni Battista Piranesi et son intérêt surprenant pour les prisons qui pouvaient inspirer des dessins de villes. On pouvait alors dire « l’architecture commence avec un dessin ».
Aucun dessin ne peut rendre compte de la réalité perçue d’un espace et pourtant notre quotidien voit naître quantité de villes sur l’eau telle la ville Oceanix, la ville flottante soutenue par l’ONU pour les réfugiés climatiques. Un projet de vie urbaine, autosuffisante, sur les mers, adaptée à un monde où les réfugiés climatiques pourront couler des jours heureux ? D’autres villes sont aussi proposées sous l’eau.
La ville linéaire, le ‘Strip’ de Las Vegas inspire une dernière utopie, dernière folie de l’Arabie saoudite, Line City : une ville futuriste, sans rues ni voitures et pourquoi pas, sans personne. Voilà un an, Sidewalk Labs dévoilait son plan pour faire de Toronto un lab d’innovation urbaine. C’était le rêve de Larry Page, co-fondateur de Google de « créer une ville dans la ville ». Finalement, la filiale d’Alphabet vient d’annoncer qu’elle jetait l’éponge. Le quartier futuriste pensé par Google ne verra pas le jour.
La ville du quart d’heure, c’est la ville traditionnelle, c’est le Paris aux cent villages, c’est le village de notre campagne, celui qui a perdu son bar/tabac et son épicerie ! Heureusement que monsieur Carlos Moreno est là pour nous expliquer comment les faire revivre : « Il s’agit d’opérer une transformation de l’espace urbain encore fortement monofonctionnel… ».
Le paradoxe est que le seul espace réellement plurifonctionnel de la ville, son bien commun, la rue et ses terrasses, devient de plus en plus monofonctionnel avec la suppression des voitures, des VTC et du stationnement… sans parler du trottoir devenu dangereux. Une dernière utopie ou folie ? Comme celle d’ouvrir les cours d’école et de nier la dimension symbolique de celles-ci.
Nos contemporains poussent le bouchon loin, très loin. Ils oublient les fondamentaux, ceux à partir desquels nous pouvons aujourd’hui penser la ville du futur, des topiques en somme, ceux qui permettent de définir « un projet » !
Certaines créations de villes chinoises montrent que les promoteurs ont oublié qu’il fallait des habitants pour vivre la ville ! Mais la ville aujourd’hui a mauvaise presse, la fuite vers la campagne est annoncée. C’est le moment de réfléchir sur le besoin de nature, sur la taille et la forme des villes.
Pourquoi est-il si difficile de regarder les bonnes raisons de vivre en ville ? L’air y est plus pur qu’à la campagne ! La sécurité y est assurée plus facilement que dans les villages retirés. Les équipements publics, les commerces, les services sont d’autant plus faciles à assurer que la densité et la mixité y sont plus facilement réalisables. En somme, il manque cette capacité à créer de l’urbanité. Le bien commun, qui en est le support, a volé en éclats sous les coups de boutoirs du fonctionnalisme.
Contrairement à Carlos Moreno, je pense qu’une ville n’a qu’un centre qui rassemble. La ville polycentrique est un amalgame, un territoire, jamais une ville. Il ne faut pas confondre l’inflation de notions de centre : centre historique, sportif, commercial, de santé, pénitentiaire, culturel… avec la réalité d’un centre qui lie et rayonne.
Certes, sans image, sans vision, il n’y a pas de place pour le rêve, alors continuons de rêver. Un architecte doit porter un projet. A l’évidence les obstacles seront nombreux mais, comme Horace, il faudra les affronter un à un.
Mon regard se porte sur le continent africain, où, dans les trente années à venir, le milliard de population supplémentaire va vivre, habiter. Comment sera la ville africaine de demain ? Quels territoires pour les accueillir ? Nos villes européennes peuvent-elles servir à penser les futures villes africaines ? Quelles formes leur donner pour qu’elles soient adoptées par leurs habitants ? La ‘smart city’ permettra-t-elle de simplifier l’économie des infrastructures ? Pourra-t-on les supprimer comme dans la Line City ? D’où viendrait l’eau qui manque si cruellement ? Avec quelle énergie les fera-t-on vivre… ?
Les réponses ont la luminosité de l’évidence. Il faudrait, sans tarder, construire non pas une muraille ou un barrage, mais un pipeline qui relie la mer à l’océan Atlantique : deux usines de dessalinisation à chaque extrémité et la desserte en eau de 1 000 villes de dix millions d’habitants chacune. La « green belt » a ouvert le chemin, reste à le suivre avec un millier de forêts de 10 000 hectares qui deviendront les centres de ces oasis modernes. Des ‘smart cities’ conçues autour de la « nature en présentiel » : l’eau, l’air, la végétation, la faune et les activités humaines seraient rendues compatibles.
L’histoire nourrit un futur qui ne sort pas tout habillé de nulle part, sauf dans les utopies dont le rôle est de faire rêver sans que rien ne change. L’expérience de l’évolution de la ville européenne nous aide à projeter un vrai projet de ville avec un centre entièrement occupé par un « fragment de Gaïa ». La nature au centre, la ville autour, les différentes formes, les différents quartiers jouant avec les continuités et les discontinuités, avec ses variations d’occupation du sol et de densité.
Tous les topiques : ville, nature, paysage, vitesse, démarche, temps, orientation concourent au dessein de cette ville projetée comme un grand paysage, avec son unité construite autour de la dilatation du centre. Chose que nous ne pouvons réaliser dans nos villes calcifiées sauf si nous envisagions que l’histoire et l’architecture jouent le même rôle que la nature : rassurer, apaiser, fusionner.
Existe-il des villes qui résultent d’autre chose que cette impérieuse nécessité de se sentir en sécurité, d’échanger, de vivre ensemble, d’être soigné, éduqué ? Nous assistons à une longue litanie de besoins que « la frugalité heureuse » tente, à juste titre, d’endiguer en oubliant l’essentiel de ce qui fait le plaisir : appartenir à une société, à une cité. Le plaisir d’avoir sous les yeux la diversité du monde, la richesse de la nature et une architecture capable d’en rendre compte.
Dans son livre Bâtir et Habiter, Richard Sennett fait une distinction que je fais mienne : la ville est le cadre, le contenant de la cité, de la société qu’elle abrite. Dans les utopies que l’on peut voir fleurir, ce n’est ni l’un ni l’autre qui anime les auteurs. Tous sont en quête d’outils pour transformer nos vies, sans que l’on sache ce qu’ils souhaitent en faire ! La ville et la cité deviennent des abstractions, des ‘ghosts cities’ (villes fantômes), avant même de sortir de terre ou de se mettre à flotter sur l’océan.
Après un siècle à courir après l’autonomie de l’art et de l’architecture, le XXIe siècle est une invitation à regarder autrement notre copie. Avec l’attention à la nature, c’est le contexte qui prend sa revanche et l’architecture devrait en tirer une magnifique leçon en se libérant du dogme du mouvement international. L’architecture doit affirmer sa différence à chaque occasion et la diversité doit être la réponse aux attentes qui se multiplient.
J’espère que la leçon sera tirée et que l’architecture en sera la première bénéficiaire. La nature et les outils numériques devraient s’affranchir de la répétition pour que la liberté s’inspire de la richesse de la biodiversité et des contextes sans être prisonnière d’une pensée « continentale », totalitaire. Répondre à la diversité des attentes ne pourra se faire qu’avec une vision « archipélique » de l’architecture.
La question d’une modernité de la diversité, d’une architecture riche des contextes nourris par la réalité et par les nouvelles technologies trouvera une réponse seulement si nous nous libérons d’une adoration, celle de l’Utopie, celle de Platon, de Thomas More et bien d’autres. On ne résoudra pas la crise du logement en espérant gagner dix mètres carrés par magie, l’incantation n’est pas une réponse.
Le projet est l’instrument du progrès. L’architecture fusion peut devenir une réalité et revêtir une dimension métaphorique. Finalement, peut-être que cette crise sanitaire aura du bon, un coup d’arrêt pour prendre le temps de réfléchir à comment faire retrouver l’amour des villes. Rien d’évident quand Leslie Kern, auteur de Feminist City, veut changer tout ça, sous prétexte que nos villes auraient un problème car « elles ne seraient pas faites pour les femmes »…
Le rêve s’éloigne, celui de pouvoir à nouveau regarder les passants à la terrasse d’un café, et ce sans se sentir coupable ! Un plaisir simple qui disparaîtrait…
Alain Sarfati
Retrouvez toutes les Chroniques d’Alain Sarfati