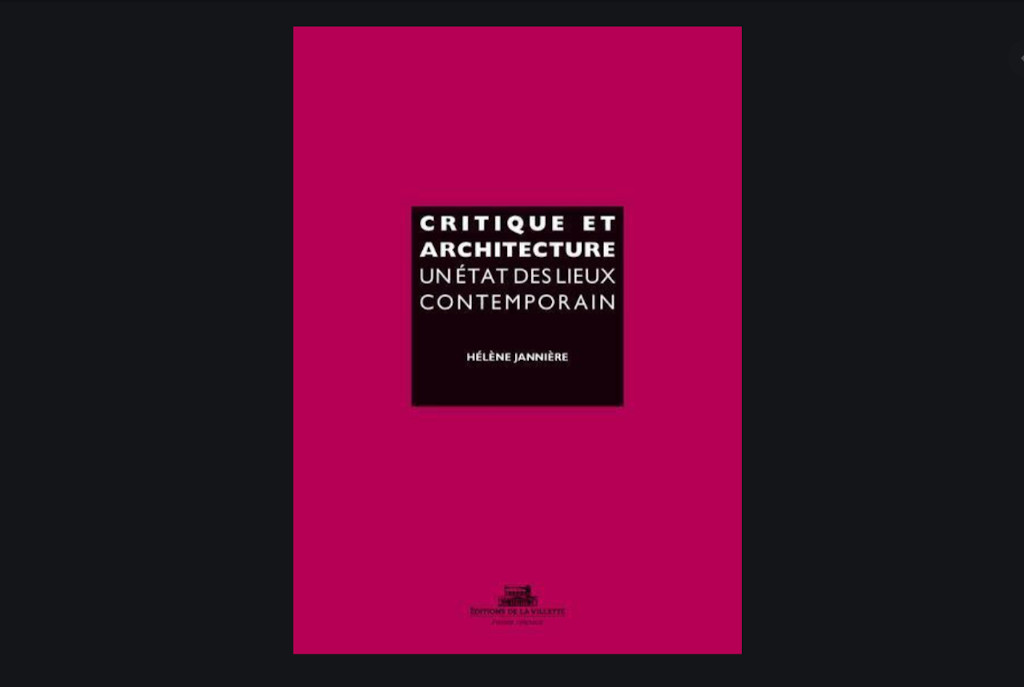
La critique d’architecture est en crise constante, en réflexion sur elle-même : son but, son langage, son rapport aux autres critiques, aux critiques eux-mêmes. La réflexion sur la construction de la critique d’architecture dans l’ouvrage d’Hélène Jannière* retrace l’histoire critique de la critique d’architecture. Retour sur certains points de cette lecture et aussi une brève réflexion sur celle-ci.
La critique d’architecture en crise(s). Tout n’est que crise, que cela soit celle de l’architecture ou celle de la critique**. La crise, qui se veut un état éphémère, est devenue permanente et sans cesse réinventée au gré des moments et des débats. Mais si « la crise est le point de départ de la critique », comme l’écrit Ignasi de Solà-Morales, le renouvellement incessant des crises devrait être fécond et vivifiant pour la critique. Or le constat est plus proche de celui d’un lent déclin de la critique et de ses espaces que de celui d’un exercice vigoureux.
En cause, les années 80, entre la fin de l’hégémonie du mouvement moderne, des utopies environnementales et technophiles – dans leur capacité à penser la société et le progrès – et la starification de l’architecture (p.16).
Si l’architecture était jusqu’alors incarnée autour de pratiques globales, appartenant à des mouvements, à des groupes d’architectes engagés, à des critiques militants, à des apports théoriques, force est de constater que le changement incarné notamment par la commande publique, et l’émergence d’architectures iconiques, ont renforcé les pratiques individuelles de l’architecture, sans pour autant produire un discours architectural.
Si la critique avait une capacité à produire ou réfléchir à un système, à nommer, à participer à la théorie de l’architecture, celle-ci s’est diluée dans l’exercice individuel et mondialisé où l’architecte perd sa capacité à penser et produire pour la société.
La course à la commande a-t-elle affaibli la théorie, la pensée architecturale, et paralysé la critique d’architecture ? Possiblement. L’architecture n’est pas un objet autonome, comme peut l’être l’œuvre d’art ou le livre. « L’architecture est le plus difficile à juger des arts », souligne l’historien de l’art Georges Oprescu (p.11). En effet, l’architecture n’est pas autonome, elle appartient au continuum de l’espace public, elle est pratiquée par tous et construite pour tous. Elle se laisse juger en permanence. En ce sens, le jugement critique peut émaner du savant comme du profane***. Mais le profane doit pouvoir être à même de valoriser l’architecture à travers le savant. Le journaliste d’architecture sert alors d’intermédiaire.
La critique d’architecture renvoie à deux façons de raconter l’architecture, à travers les revues professionnelles et à travers la médiation grand public, dont les journalistes architecturaux sont les passeurs.
La rupture entre les deux espaces médiatiques est aujourd’hui flagrante. L’une se cherche dans une étude patiente, un débat continu, une connaissance experte du sujet. Les débats qui l’ont animé ont été contingents de son lien à la théorie, à l’histoire, à l’engagement politique ou esthétique, au projet lui-même en tant que pratique de l’architecture, à son rapport aux critiques artistiques. Or ces publications n’existent quasiment plus, et sont de plus en plus sponsorisées par des architectes en mal de notoriété.
De même que les journalistes d’architecture, peu appréciés en France, sont de plus en plus faibles, sinon absents, dans les rédactions. Si le critique d’art ou littéraire jouit d’une aura encore préservée avec des suppléments pour les titres de presse nationaux, l’architecture ne bénéficie absolument pas de ce privilège. Les passeurs d’architecture qu’ont pu être Frédéric Edelmann ou François Chaslin n’ont pas de relève actuellement dans le paysage médiatique, signifiant le désintérêt pour l’architecture de la part de la presse généraliste.
Aujourd’hui, les journalistes se contentent de comptes rendus de visite liés à des actions de communication émanant plus souvent des investisseurs (promoteur ou financier indifféremment) que des architectes (hors prix professionnel). Les journalistes n’ont plus la capacité de traiter l’architecture avec l’appui d’un discours intellectuel. Ce qui laisse place à un journalisme de papier glacé.
La crise de la critique est-elle aussi un symptôme de la crise de la profession ? Peu d’architectes ont une capacité à produire un discours intellectuel, à se poser en héraut. La critique, mais par-delà la pratique aussi, s’est diluée « dans la médiatisation, ses interférences avec la campagne de communication, son indépendance sans cesse menacée et enfin la perte de ses valeurs et l’effacement des engagements esthétiques et politiques, (…) mais aussi lien trop distendu avec la théorie », explique Hélène Jannière.
Cette dilution de la critique est aussi contingente à un état de l’architecte, celui-ci tributaire de la commande, ne pose plus de regard réflexif, théorique, d’engagement sur sa pratique et sa profession. Hormis des actes accusatoires, point de renouvellement de la pensée à même de nourrir la critique.
Finalement, cette critique en état critique n’est-elle aussi que le symptôme du triomphe du capitalisme, de cette inversion du rapport de force entre maître d’œuvre et maître d’ouvrage ? Les architectes en qualité de prestataires sont devenus bien incapables de produire des discours. Bien plus qu’une crise de la critique, la crise paraît être celle de la profession.
Julie Arnault
* Hélène Jannière, Critique et architecture, un état des lieux contemporain, Editions de la Villette, Paris, 2019
** Lire notre article Plaidoyer pour l’utopie, plus indispensable que le superflu
*** Lire notre article « Archimoche » ou l’architecture en 20 minutes et peu de caractères