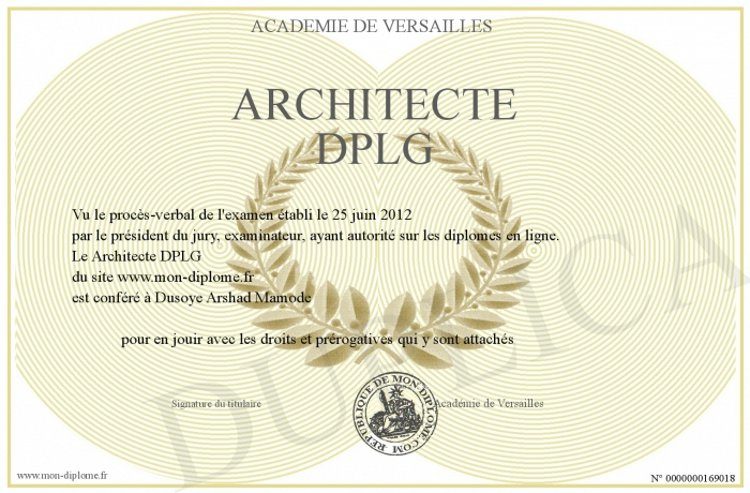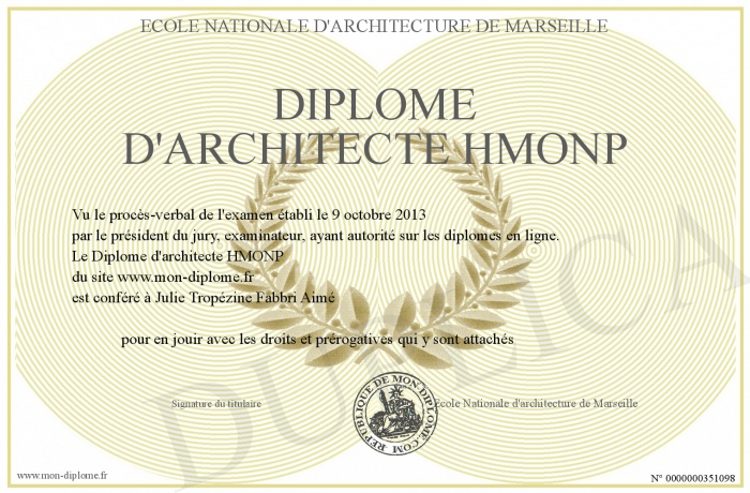Comment les agences d’architecture et les étudiants se sont-ils adaptés (ou non) à la HMONP ? La réforme a-t-elle réellement simplifié les choses avec l’Europe ? Quels en sont les aspects positifs et négatifs ? A l’heure des rendus de Projets de Fin d’Etudes (PFE) et des courses à l’inscription vers l’habilitation, voyons ce qu’en pensent les « dplgistes » et les « hmistes ».
Suivant de près la réforme de 2005 organisant les études d’architecture dans le système Licence Master Doctorat (LMD), celle de la HMONP, votée par arrêté en 2007, a bouleversé le système d’enseignement de l’architecture. Pour quel bilan plus de dix ans après ?
Derrière cet acronyme à rallonge, signifiant «Habilitation à la Maitrise d’œuvre en son Nom Propre» s’en cachent d’autres. Avec l’HMONP, l’ADE – comprendre Architecte Diplômé d’Etat – qui a obtenu un diplôme après cinq ans d’études, en reprend pour une année, dont une MSP – pour Mise en Situation Professionnelle –, 150h d’enseignements théoriques et un mémoire d’une trentaine de pages. Après quoi, enfin architecte tout court, il pourra s’inscrire à l’Ordre et signer ses propres permis de construire. Dit autrement, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une sixième année d’études, en alternance, qui mène à une licence d’exercice, sans laquelle il est difficile d’espérer mieux qu’un poste de dessinateur / projeteur.
Pour les impétrants de la génération hmiste, un bref rappel s’impose sur ce qui se faisait avant, quand l’architecte était diplômé par le gouvernement, dit DPLG : une formation de troisième cycle universitaire délivrait un Bac+6 (une sixième année assumée ?). Fraîchement sorti de l’école, l’architecte DPLG pouvait aller braver tous les dangers du métier et monter sa propre agence au lendemain de l’obtention de son diplôme. Un diplôme qu’il avait obtenu seul, après deux ou trois ans de travail parfois. Mais qui ne délivrait aucune compétence en matière de gestion d’agence.
«Pour ma part, je suis DPLG comme la plupart des personnes qui s’occupent de la formation HMONP dans les écoles, et nous nous rendons compte que nous aurions été vraiment contents d’avoir ce type de formation avant de s’inscrire à l’Ordre et d’exercer», raconte Minna Nordström, responsable pédagogique HMONP à l’ENSA Paris-La Villette. «La responsabilité de ce que signifiait être architecte n’était pas systématiquement abordée, on s’inscrivait à l’Ordre sans même connaître notre posture, notre stratégie, notre ‘business plan’», se souvient-elle.
La HMONP avait donc pour but, dans un premier temps, de délivrer des compétences liées à la gestion d’une agence. Pari réussi, semble-t-il. «Lors de cette habilitation, nous prenons conscience de ce que signifie monter une entreprise et nous rentrons en confrontation avec les problématiques de gestion, de droit, d’assurance, l’intérêt des marchés publics ou privés. Des débats sont organisés avec différentes agences, BET ou promoteurs. Cela permet de développer un point de vue critique et c’est très bien car, il ne faut pas se leurrer, en sortant de l’école, nul n’est formé à travailler avec Bouygues», témoignent les hmistes.
L’autre objectif de la HMONP était d’uniformiser le système à l’échelle européenne, afin que l’architecte puisse exercer plus simplement à l’étranger – si tant est qu’il ait eu des difficultés auparavant. En tout cas, l’esprit du projet était d’assouplir les frontières comme peut le faire l’ERASMUS.
En réalité, si l’intention était vertueuse, ce n’était que cela, une intention, car chaque pays continue de faire les choses à sa manière. En Italie par exemple, il faut passer un examen sans cours qui lui sont liés. Le prétendant à l’équivalent italien de la HMONP devra potasser seul et apprendre par cœur la législation avant de pouvoir prétendre exercer. Voilà ce qu’il en est pour la formation certainement la plus courte. A l’inverse, en Angleterre, la «Part three», équivalent à l’HMONP demande le même investissement qu’un projet d’architecture complet et peut durer de deux à trois ans.
«Le système français est un bon compromis entre ces deux extrêmes», estime Minna Nordström. «A partir des séminaires, des débats et de la réflexion que mène l’ADE dans son mémoire, il s’agit de se construire une posture, de savoir où chercher la règlementation, et non d’apprendre par cœur des règles qui ne cessent d’évoluer», dit-elle.
Pourquoi alors sortir cette formation, de 150 h seulement, du cursus LMD ?
Premier argument, un brin trop idéaliste : permettre à l’ADE de passer cette habilitation quand il le souhaite, notamment une fois que le prétendant à l’habilitation a un objectif professionnel précis. La différence avec la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) ne saute pas aux yeux, hormis que cette dernière demande beaucoup plus d’investissements (trois ans) pour être obtenue même si le jeune aspirant à construire en son nom propre justifie de nombre d’années d’expérience. Comprenne qui pourra.
Dans les faits, dans la plupart des cas, le hmiste cherche avant tout à mettre un point final à sa formation, sans laquelle elle aurait un goût d’inachevé. La HMONP est pour lui bien souvent sa première expérience professionnelle, dans un cursus devenu très scolaire, une surprise ou un choc selon les caractères ou les expériences de chacun.
Ce qui amène au second argument : l’étudiant ne porte pas d’intérêt aux questions abordées en HMONP avant d’avoir une expérience professionnelle. «C’est un vrai bon point que l’habilitation soit sortie du cursus et surtout mise en regard d’une insertion professionnelle car il est nécessaire d’être impliqué dans une agence et d’avoir une expérience pro pour comprendre les enjeux qui sont abordés en parallèle durant les cours théoriques», expliquent les hmistes.
Troisième argument, et non des moindres : si la formation était intégrée au cursus sous forme de cours magistraux, l’absentéisme serait certain… Sans sanction au diplôme, c’est une évidence.
Sauf que cette alternance entre pratique en agence et cours théoriques est la bête noire de la HMO. D’une part, comme le déplorent les étudiants, il est difficile de cumuler une formation à un travail en agence qui, chacun le sait, dépasse souvent largement les 35h légales. Côté agence, les 150 h réparties différemment, selon les cas d’écoles, rajoutent des complexités d’organisation.
Autre complexité, le statut auquel est livré le hmiste : non stagiaire puisque diplômé mais salarié en formation. «Il est vrai que le statut HMO n’est pas clair, à l’époque les négociations n’ont pas abouti à un statut spécifique», souligne Minna Nordström. Il est quoi alors, notre hmiste ? Et bien il fait l’objet d’une convention tripartite, entre l’agence, l’école et lui-même, si ce n’est quadripartite lorsqu’une ‘junior architecte’ (association à but non lucratif loi 1901, intégrée à l’école) s’en mêle. Rien que ça !
Dans ce dernier cas, si l’ADE est inscrit en ‘junior architecte‘ (ce qui reste aujourd’hui une minorité) le hmiste est un étudiant, avec une carte d’étudiant. Il ne dispose pas des avantages liés au salariat, comme les congés payés, l’assurance-chômage, la cotisation pour la retraite, etc. et, pour sa part, l’employeur diminue ses charges salariales.
Certains employeurs revoient les salaires à la baisse, abusant de ce statut, sous prétexte que le ‘hmiste’ est toujours en formation. Pas étonnant donc que ces mêmes agences se jettent sur ces profils, voire qu’elles en fassent une condition d’embauche.
Cela dit, nombre d’agences savent aussi, au-delà de son coût, trouver un intérêt pédagogique à cette habilitation et mettre à profit les connaissances du hmiste pour améliorer leur propre structure, c’est le cas notamment des agences unipersonnelles.
Pour finir, avec ou sans cette habilitation post-diplôme, demeurent deux types d’architectes : ceux qui peuvent construire et ceux qui ne le peuvent pas. Un architecte qui ne construit pas est-il encore un architecte ?
Amélie Luquain
Lire également notre article HMO à la française, une fumisterie
*Aujourd’hui, responsable pédagogique HMONP à la Villette, chercheuse sur la « Génération HMONP** » participant à des groupes de travail sur le sujet réunissant le ministère de la culture et les organismes professionnels
** Génération HMONP – La mise en situation professionnelle dans la trajectoire de l’architecte diplômé d’État et la construction de son projet professionnel. Étude qualitative et quantitative sur la MSP à l’ENSA Paris La Villette (2016-2017. responsables de la recherche : Minna Nordström et Elise Macaire)