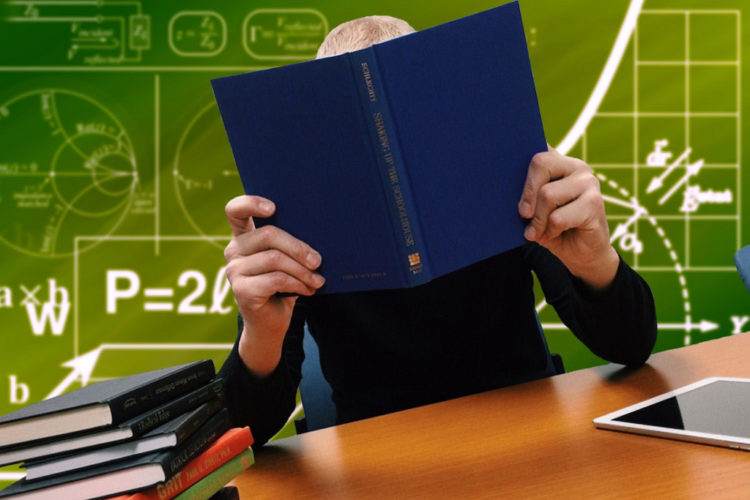L’agence est régulièrement sollicitée pour bien vouloir recevoir un ou une collégienne en stage pour une semaine. Découverte du monde du travail ? L’intention est louable même si j’ai toujours trouvé cette pratique sans grand intérêt. Que peut-on apprendre et voir en cinq jours lorsqu’on a quatorze ans ?
Cette fois cependant, c’est moi qui ai appris quelque chose lorsqu’une jeune fille m’a demandé si le métier d’architecte était un métier d’avenir ? Il me fallait lui répondre sans briser son enthousiasme.
Si c’était à refaire ? Je referai des études d’architecture car je pense que son enseignement couvre un très large domaine et qu’il s’ouvre sur de nombreuses activités d’avenir. Je pense que Le Corbusier avait raison quand il disait que «l’architecture est une tournure d’esprit, non un métier». Toutefois l’architecture mérite beaucoup mieux que ce que l’on en fait ; l’architecture est une façon de transcrire et de concrétiser l’écoute d’un programme, d’une commande. Plus encore, l’architecture c’est aussi proposer du nouveau, du surprenant, de l’inattendu, c’est faire partager du plaisir.
Cette écoute est celle d’une société tout entière, dans sa diversité, dans sa complexité. Se construire une culture architecturale, c’est bien mais pas seulement. Etre à l’écoute, c’est appréhender une histoire large et ne pas se contenter de quelques archétypes vite appris. Etre à l’écoute, c’est comprendre que l’histoire, celle de la commande, celle des techniques de construction, celle de la formation des styles, celle de l’intimité du logement ou celle des villes sera déterminante pour le parcours professionnel des futurs architectes.
S’il est vrai que dans les études d’architecture la notion de projet est centrale, cette notion engendre une réflexion sur les démarches, les processus d’invention que seules les études d’architecture ont le privilège de développer. Le projet, en architecture, c’est d’abord de constituer l’architecture comme réponse à une attente non formulée. L’architecture comme projet est une proposition qui ne recouvre ni besoin, ni attente, mais qui rend compte d’une vision de la société et en cela elle est de la plus haute importance.
Le projet est un dessein avant d’être un dessin. Quatre mille ans de monuments, de palais, de cathédrales, de temples, de mémoire, de cénotaphes et brusquement une ouverture sur la vie. La modernité a fait passer l’architecture de la représentation d’un ordre totalitaire à un ordre démocratique, elle a changé de projet. C’est le corpus entier qui est à reconstituer, pour que ce soit la vie qui prenne la place occupée jusque-là par la mort.
La mission de l’architecte, selon moi, est apporter une réponse à une commande (rarement faite), c’est accepter de se mettre en danger et de partager les affres de la page blanche. Cette question de l’attention n’est posée ni au peintre ni à l’écrivain ni au musicien. Développer un projet, c’est le conduire à travers tous les écueils et c’est le rôle de l’architecte seul.
Alors que dire de l’évolution des pratiques qui limitent l’intervention de l’architecte à un dépôt de permis de construire ? Ce sera rarement de l’architecture à l’arrivée si le projet n’est pas conduit par un auteur, l’implication de l’architecte devant se faire tout au long du processus. Le métier d’architecte sera magnifique si, un jour, les compétences retrouvées, cette nécessité est à nouveau prise en considération. Comme le droit mène au métier d’avocat, l’architecture mène au métier d’architecte. Si c’est la voie choisie, les débouchés ne seront pas nombreux.
Pendant les brefs séjours de stagiaires à l’agence, j’insiste sur les fondements culturels de l’architecture. L’idéologie de la créativité suppose que chaque individu porte une capacité à créer et qu’il suffit d’activer. Pourquoi pas, mais il faut aussi du carburant, c’est-à-dire une culture au sens large, une culture ouverte, beaucoup de curiosité. Sans cela l’aspiration s’épuise très vite et les dégâts sont considérables.
Il y a deux façons de procéder : la première consiste à suivre une architecture académique, conventionnelle, véhiculée par quelques revues qui l’utilisent sous la forme d’illustrations ou d’images comme vecteurs et attracteurs de publicité. C’est un peu le système des Beaux-Arts qui s’est renforcé en ne gardant que les mauvais côtés.
Pourtant le monde change. Dans les cinquante dernières années, le «métier» d’architecte s’est transformé plusieurs fois avec la décentralisation, le nombre croissant d’architectes, l’évolution des modes d’accès à la commande, l’évolution de la nature de la commande et de la maîtrise d’ouvrage, l’avènement de l’informatique, l’envahissement de l’espace par les images, la représentation et l’impression 3D…
Ces mutations emportent une complète reconfiguration des programmes et c’est là que je veux en venir. Pendant un demi-siècle, les réformes n’ont pas cessé de se succéder mais quelle école peut aujourd’hui clairement démontrer que la problématique du projet, sous toutes ses dimensions, est au cœur de son enseignement ? Innovation, invention, création… L’architecture comme objet est probablement un des domaines les plus riches, il est transversal et pluridisciplinaire par nature. L’architecture est un enseignement du projet, c’est aussi l’enseignement de l’architecture comme projet.
D’un enseignement éthique, nous sommes passés à un enseignement pléthorique, boulimique, sans que les matières enseignées se soient clairement adaptées au domaine. On voit une transposition pure et simple d’éléments juxtaposés, constitués de domaines de connaissances sans lien direct avec l’architecture.
Question de programme, chacun enseigne ce qu’il connaît et l’institution n’est pas une instance de commande, ce qu’elle devrait être. Quelle construction, quelle histoire, quelle sociologie, quelle culture générale, quel regard, quel droit ? Avec le temps, l’enseignement s’est emparé de la ville, des territoires, des paysages, des montagnes, des déserts et des océans ! L’essentiel est d’apprendre à construire un problème pour le concrétiser, c’est la différence avec la philosophie qui, pour Gilles Deleuze, est l’art de construire des problèmes.
Je pense qu’il y a une deuxième manière d’aborder le sujet. Si le monde professionnel se transforme de plus en plus, la formation permanente va être la règle et il ne sera plus possible de dormir sur son diplôme. Il faudra raisonner en perspectives, en domaine de connaissances, en secteur d’activité, en champ d’action.
L’enseignement doit s’ouvrir en permanence sur les nouvelles technologies, les innovations et rester à l’écoute de la société.
Pour former des architectes, au sens le plus large possible, je propose de retenir six champs d’action de l’enseignement, du design au paysage, de la maison à la ville. La Conception, la Construction, la Commande, la Communication, la Critique et la Culture vont permettre de constituer un Corpus solide, ouvert et renouvelable. Six piliers pour un temple hexastyle, le plus élégant, pour donner une structure élémentaire lorsque l’on sait que la connaissance des villes peut se décliner à toutes les échelles et que le développement durable est une préoccupation permanente comme la diversité, réponse au monolithisme qui se met en place.
L’architecture est une forme de résistance à la monotonie, à l’uniformisation, une résistance active, constructive. Si l’architecture est une discipline technique, elle est aussi artistique et a également une visée sociale. C’est cette complexité qui en fait un domaine d’élection passionnant. Passer de l’entreprise à l’expérience, de la maîtrise d’œuvre à celle de la maîtrise d’ouvrage, dessiner des meubles et des jardins, inventer un concept urbain, voilà de quoi remplir une vie active. Pourquoi la Critique dans ces champs d’action ? Par critique j’entends : développer une capacité à se remettre en question, à évoluer, à voir la formation comme un enrichissement permanent.
Vous me trouvez bien critique ? Vous avez raison. Mais vous comprendrez l’importance qu’il y a à réclamer un enseignement de l’économie digne de ce nom, car il n’y en a pas. Les architectes verront l’intérêt d’apprendre à conduire un projet et à ne pas se laisser mener par les outils. L’enseignement de la psychologie historique est édifiant à ce sujet.
Beaucoup reste à faire et les choses vont encore évoluer. En empruntant la voie de l’architecture, on a à la fois de la chance d’avoir tout à découvrir et de ne pas avoir été encore déformé par le regard biaisé des idéologues de tout poil. Le handicap, par contre, c’est le vide à combler, une soif de comprendre et de découvrir impossible à étancher. L’avenir de l’architecture et des architectes se joue dans l’enseignement, la formation, une longue formation.
Alain Sarfati
Retrouvez toutes les chroniques d’Alain Sarfati.