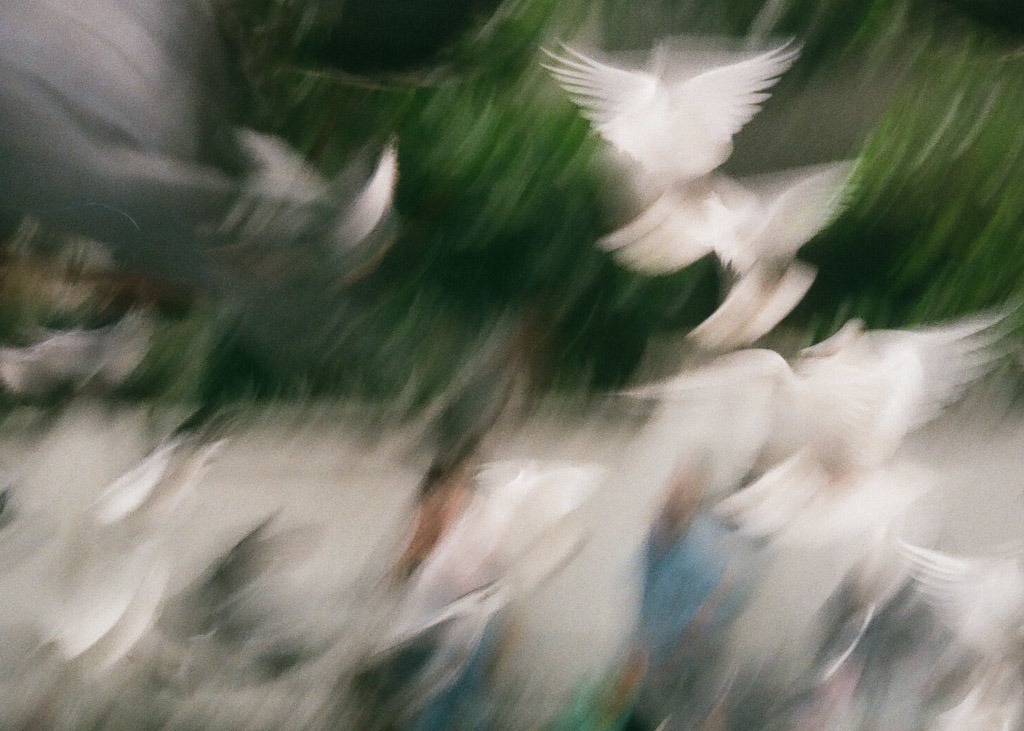
En tant qu’architectes, dessiner et progresser demande des références. Celles-ci nous habitent tous les jours, elles sont l’éveil de notre créativité et sont des garde-fous dans un monde uniforme où la mondialisation homogénéise et lisse tout. Chronique du Mékong.
Cây thẳng bóng ngay. Cây nghiêng bóng vạy (À l’arbre droit, l’ombre droite. À l’arbre tordu, l’ombre tordue)
Introduction
Jean-François Milou fait partie de ces architectes de référence, il travaille en Asie du Sud-Est depuis vingt ans. Silencieux, il construit une œuvre, un style, avec patience et force, travail et conviction, avec obstination. Ses bâtiments ont une grande cohérence.
La poésie et l’inexplicable force de l’émotion participent à un langage silencieux que je partage avec lui ; c’est la dialectique d’un artisan avec la matière, la forme et la composition.
Il émeut en créant une pluie de lumière ou lorsqu’il tamise d’ombres les péristyles qu’il dessine entourés d’harmoniques fines colonnes en milieu tropical.
Jean-François Milou est né en 1953, il vit et travaille à Singapour, il dirige avec son équipe bienveillante et ses proches une seconde agence à Hanoï au Vietnam.
Dans ce pays, il signe la réalisation du centre scientifique et de conférences de Quy Nhon ainsi que le musée de Danang inauguré fin mars 2025.
Il a réhabilité la Galerie Nationale de Singapour et le Carreau du Temple à Paris.

Échanges
Olivier Souquet : « Jean-François Milou, cela fait longtemps que je souhaitais cette conversation. Depuis que nous échangeons respectivement sur nos agences en Asie du Sud-Est et au Vietnam, je voulais t’interroger sur ta perception de la production architecturale actuelle en France, un pays que tu as quitté professionnellement depuis bientôt quinze ans et où tu as construit de très belles références ? »
Jean-François Milou : Olivier, nous en avons déjà parlé, nous assistons en Europe à une dérive du métier d’architecte qui tend à devenir un simple rouage d’ajustement de l’économie. En donnant aux architectes un contrat social, puis environnemental, d’aucuns pensaient offrir au métier beaucoup de noblesses mais au fond tout a été enlevé aux architectes ! L’évolution pluridisciplinaire de l’architecture comme une discipline « au service de », me paraît absurde.
S’il faut tenter de donner une définition à l’architecture, commençons par dire ce que l’architecture n’est pas. L’architecture n’est pas une discipline de résolution de problèmes fonctionnels de l’économie. L’architecture n’est pas une discipline avançant pas à pas sur la base d’évidences chiffrées suivant des protocoles formatés par des économistes, des sociologues, des écologies, et des hommes politiques.
L’architecture est, ce qu’elle a été de tout temps, un travail de composition géométrique complexe appliquée aux situations et aux paysages. Or comme pour la disparition de la communauté religieuse en Occident, nous assistons à la disparition de la « communauté géométrique ».
La sociologue Hervieux Léger a observé comment le sentiment religieux avait quitté les grandes institutions et s’était fragmenté pour investir partout les boutiques et les univers individuels (yoga, wellness, méditation, etc.). La même chose peut être dite de la « première géométrie collective », qui s’est effacée du champ architectural collectif et s’est fragmentée partout en Europe pour investir les champs du tourisme du design, de la publicité, du cinéma, etc.
Si tu me demandes de parler en tant qu’architecte de ce que je fais, je n’y arriverai probablement pas. C’est seulement en regardant les projets construits par notre studio pendant une durée d’environ 30 ans que l’on trouve des réponses à cette question. Notons quand même que nous avons nettement déplacé le centre de gravité de notre travail vers l’Asie depuis 2009.
Il est vrai que l’Asie tropicale nous permet de juxtaposer un riche travail architectural par éléments sculpturaux en introduisant des structures très fines, dans des paysages extraordinaires… Travailler dans des sociétés qui gardent des traditions vivantes (famille, hiérarchie des âges, travail artisanal) favorise un classicisme dans la résolution d’ensemble et une expérimentation intuitive dans la résolution de tous les détails.
Oui, je suis d’accord avec toi, parler de beauté est inaudible en France, les architectes justifient sans cesse ce qu’ils font et ce n’est certainement pas la bonne manière de se valoriser. Parler d’émotion pour un architecte, c’est dur, décortiquer pourquoi l’on aime les choses n’est pas simple. Le silence des espaces de Barragan ne s’explique pas, ses cadrages de paysages sont quasi mystiques !
L’architecture est quelque chose de fondamental et de très traditionnel à la fois, il est difficile d’expliquer pourquoi cela marche.
Il me semble quand même que l’architecture est très en retard par rapport à la composition musicale, l’histoire de la musique, l’harmonie, le contrepoint. Regarde comment les musiques classique et contemporaine ont pu résister dans ce monde, alors que l’architecture peine à exister et doit en permanence s’expliquer !
J’aurais tendance à dire que l’architecture est le croisement d’une tradition géométrique collective qui dépasse l’architecte avec une intelligence émotionnelle appliquée aux paysages et aux situations.
L’âme d’une composition est en disharmonie avec le langage : une fontaine posée ici, un mur composé à telle hauteur, un chemin qui serpente… C’est établi, ça ne se discute pas !
Ton architecture est écrite, tu développes un vocabulaire, un style, même une couleur particulière en rapport au sol, à la nature… Peux-tu en dire plus sur les tensions, les connexions que tu opères dans tes projets ?
J’aurais tendance à dire que nous avons oublié ce qu’était la gravité. C’est-à-dire la masse, le poids, c’est quelque chose qui agit constamment.
Dans nos projets, nous travaillons à ramener la densité du design vers le bas, pour ramener les ombres et les contrastes vers le sol. De même nous cherchons à ramener les couleurs chaudes vers le sol et à laisser s’échapper les couleurs froides vers le ciel. À l’intérieur, quand nous travaillons à faire des meubles, nous ne cherchons pas à dessiner des meubles plus haut qu’un mètre vingt. Je pense qu’il y a là un accompagnement visuel intuitif de la force de gravité dans la composition.
Dans notre travail, on trouvera la répétition d’éléments récurrents, les fines colonnes, les écrans qui filtrent la lumière, les murs sans fenêtres… C’est un travail de reconstruction d’un vocabulaire géométrique, de règles de composition, de leitmotivs, de détails d’assemblages, de principes de mise en œuvre… Mais si je devais dire ce que nous faisons, je dirai que nous cherchons à installer dans notre pratique une manière de faire, un style propre.

Oui, c’est avec un vocabulaire que l’on arrive à composer, comme un livre qui se compose de lettres qui forment des mots, puis des phrases et des chapitres. Il faut de la cohérence, l’effort pour tenir un vocabulaire, et ce notamment au Vietnam. Tu peux me parler de ta fascination pour l’archéologie ?
J’ai été très formé par mes études d’archéologie. Je me suis intéressé à l’apparition des systèmes géométriques collectifs dans les premiers grands empires d’une part, et à l’apparition des premières villes d’autre part. Je considère depuis cette époque l’archéologie comme l’avant-garde de la recherche architecturale.
Je travaille comme toi beaucoup plus sur l’articulation des projets dans le sol (matérialisme, classicisme), par la création d’un podium massif résistant au temps, sur lequel les pavillons changent, le second œuvre tourne… Tout projet de qualité rêve de sa forme archéologique…
Si l’on se réfère aux villes indiennes et leurs géométries puissantes, la gestion savante de l’eau, c’est une grande histoire de la projection humaine de la géométrie au sol qui complète la géographie naturelle, la topographie. Je pense comme toi que la géographie de l’homme s’imprime sur la géographie, c’est de cet entrelacement entre géométrie et géographie que se construit une densité, une raison, une histoire, une émotion furtive. L’architecture est en rapport au lieu, au site que l’on modifie irrémédiablement. Mais revenons sur l’essentiel, l’intuition, comment viennent les choses ?
J’ai aussi été influencé par mon intérêt pour la haute couture, avec un grand-oncle, musicien, financier et ami intime de Cristobal Balanciaga. les défilés de mode sur des socles en pierre au clair de lune me paraissent intuitivement une perfection de civilisation.
Je t’ai dit que le travail de l’architecte était de croiser une tradition géométrique avec une intelligence émotionnelle appliquée aux paysages et aux situations.

Ce que tu évoques, et qui revient souvent, est l’écart entre la pensée analytique et la pensée synthétique. Cette divergence entre l’intelligence émotionnelle et analytique. L’architecte serait écartelé au centre de tout cela ; émotif sensible, il est au cœur de tant d’intentions qui cohabitent. Un bâtiment c’est la mise en tension d’efforts, de technique, de poids et de transparences, de logiques et de coûts. Et, dans tout ce travail on aurait omis de parler de l’essentiel ?
Quand vous utilisez votre intelligence émotionnelle, il faut savoir oublier ce qui vous vient de l’intelligence analytique. C’est assez difficile à faire comprendre quand on vit dans un monde technique et économique où tout est régi par l’approche analytique. L’architecture en acceptant de se développer selon des critères analytiques (études d’impact, tableau chiffré de critères, diagnostic…) devient une discipline secondaire de l’économie.
C’est aujourd’hui visible en Europe où l’architecte est entraîné à justifier ses décisions sur la base de critères dérivés de l’économie : tableaux de performance, bilan carbone, performance environnementale, label…
Or les paysages et les situations humaines sont trop complexes pour être abordées par l’intelligence analytique. Dans un paysage, chacun est perdu sans l’intuition, on n’y survit pas. Aucun animal ne peut survivre dans le paysage sans cela, aucun sportif ne peut gagner un match sans cela, aucune mode ne peut plaire sans cela…
Ce n’est pas moi qui vais te contredire… Tu veux dire que la pensée inclusive tue l’architecture, que nous nous serions fourvoyés dans un monde où l’architecte doit toujours tout justifier, au contraire d’un artiste. Pour autant, il nous est demandé de toujours tout réinventer, d’être innovant…
C’est en partie vrai. Par exemple le sculpteur Giacometti est un artiste qui fait toujours la même chose et auquel nul n’a jamais demandé de s’expliquer sur sa répétition des choses… Son travail est énorme, sa contribution à simplifier et n’expliquer qu’une seule chose est l’exercice d’une vie. C’est comme le travail de Mies ou son unité de style atteignait une dimension sculpturale.
Les artistes, les animaux peuvent résoudre des choses très complexes, à une vitesse phénoménale et inexplicable. C’est certainement ce qu’on nous demande, on l’a un peu oublié.
Tu parles souvent de « méditation moderne » que l’on trouve dans tes bâtiments et il y a aussi la question du style et de la répétition que l’on trouve dans la musique contemporaine ?
Oui c’est l’élaboration d’un style qui m’intéresse. Je constate qu’en France ou en Asie, j’ai tourné autour des mêmes choses, composé avec les mêmes idéogrammes architecturaux. J’ai toujours cherché à installer dans des paysages luxuriants ou le vent et la lumière circulent, où la vie, les rythmes, les traditions se déploient, des murs sans fenêtres, des écrans monumentaux, des files de fines colonnes presque verticales, des murs de verres sans structures, de larges emmarchements couchés sur le sol…
Il me semble que Nietzche voit juste quand il dit : « Le bien est quelque chose que l’on peut se voir répéter un nombre infini de fois, alors que le mal est un acte que l’on ne se voit pas répéter une infinité de fois ».
Il me semble qu’un « style architectural » , c’est la mise en place par le travail d’éléments – fines colonnes presque verticales, écrans qui filtrent la lumière, murs de pierre sans fenêtre, mur de verre, etc. – que l’on peut s’imaginer répéter une infinité de fois.
Olivier Souquet
Retrouvez toutes les Chroniques du Mékong
Jean-François Milou
Né à Niort en 1953, Jean-François Milou est diplômé de L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il a fondé studio Milou architecture en 1988 à Paris, où il a développé une agence spécialisée dans la réutilisation des bâtiments anciens, les musées et les grands projets culturels. En France, il a notamment réalisé, entre autres projets, le Musée des tumulus de Bougon dans le centre ouest de la France, la Cité de la Mer à Cherbourg en Normandie, le Musée Nationale de l’Automobile à Mulhouse et la Carreau du Temple à Paris. Suite à un concours international, Jean-François Milou a été sélectionné pour réaliser la Galerie Nationale de Singapour, et a créé en 2009 Studio Milou Singapour. Depuis, il a aussi créé le studio Milou Vietnam en 2017, où il a reçu en 2015 le prix du meilleur architecte international pour le Centre de colloque pour les études inter-disciplinaire en science et éducation à Quy Nhon.
En parallèle , Jean François a été un consultant pour le Centre du patrimoine mondial de L’Unesco, et est intervenu sur les sites historiques de Dohla Virha et le Taj Mahal en Inde, ainsi que Lumbini au Népal. Il a aussi assuré en Géorgie la restructuration du Musée Nationale de Géorgie à Tbilissi.
Tout au long de sa carrière, la sensibilité de Jean-François Milou aux contextes a toujours privilégié un design simple, lisible mais novateur, utilisant des matériaux appropriés et respectant le tissu des bâtiments existants, dans leur environnement architectural, urbain, naturel et culturel. Cette approche claire et disciplinée, néanmoins très sensible, de son travail architectural lui a valu à Singapour en 2018 la décoration du Chevalier de l’Ordre du mérite pour sa contribution à l’architecture française et internationale. Il est membre de l’Ordre français des architectes, de l’institut des architectes de Singapour, de l’Institut australien des architectes, et de l’institut royal des architectes du Royaume-Uni.