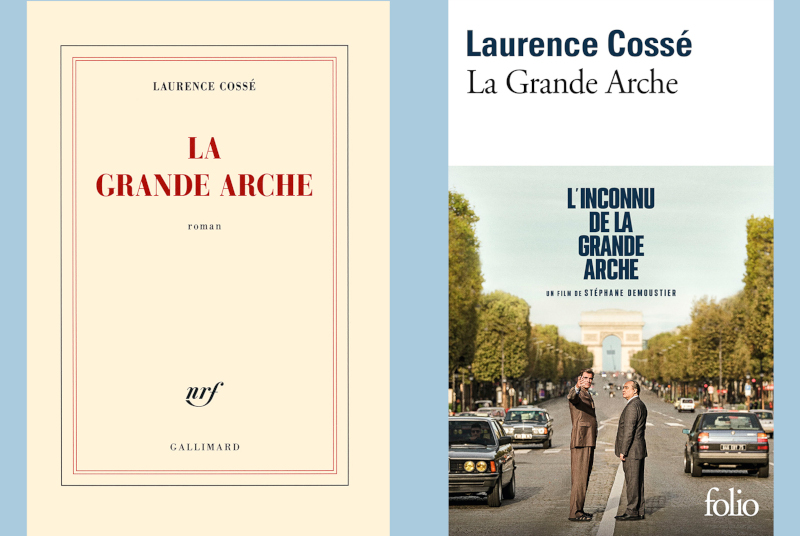À une semaine de l’avant-première aux 400 coups d’Angers, du dernier film de Stéphane Demoustier « L’inconnu de la grande arche » (en salles, le 5 novembre 2025), relisons l’ouvrage de Laurence Cossé « La grande arche ».
Ce roman a donné l’idée au cinéaste de revenir sur cette histoire au romantisme tragique d’un des projets les plus emblématique des Grands Travaux de François Mitterrand. Ou comment le savoir-faire français a broyé un architecte danois au nom très aristocratique de Johan Otto von Spreckelsen.
Pour une partie de ma génération, celle rentrée en école d’architecture en octobre 1990, et marquée par le bicentenaire de la Révolution française l’été précédent, l’Arche de la Défense marqua indéniablement les esprits. À l’époque, si vous étiez issus de la classe moyenne et si vous aviez passé votre adolescence dans un lotissement des plus ingrats comme il en existait déjà beaucoup trop en France et ailleurs, les Grands Travaux de Mitterrand (1981>91) furent un accélérateur quant à la décision de « faire archi » ! Histoire d’imaginer changer les choses – surtout ces contestables lotissements ; quelle innocence …
Néanmoins, le Grand Louvre et la Pyramide du Louvre (1981-1988, Ieoh Ming Pei), la Cité des sciences (1986, Adrien Feinsilber), l’Institut du Monde Arabe (1987, Jean Nouvel), le parc de la Villette (1987, Bernard Tschumi), le ministère des Finances (1989, Borja Huidobro et Paul Chemetov), l’Opéra Bastille (1989, Carlos Ott), et la Grande Arche de la Défense (1989, Johan Otto von Spreckelsen) ; puis pendant les cinq années d’études en architecture : la Cité de la musique (1995, Christian Portzamparc) et pour terminer le double septennat la Bibliothèque nationale de France (1995, Dominique Perrault), devenue le site François Mitterrand de la BnF, tous ces Grands Projets auront égrené l’actualité et les débats sur le choix des architectes, les formes architecturales plus ou moins heureuses selon les critères de chacune et chacun, le bien-fondé des programmes et des emplacements ; la vie de l’architecture en somme.
Tellement loin de la médiocrité des maisons dites « traditionnelles » qui pullulent dans nos chères zones pavillonnaires. Heureusement que les habitants savent cultiver leur jardin afin de cacher cet horrible bâti, subi par la majorité qui n’a d’autres choix, vu le coût du foncier.
Revenons aux Grands Travaux.
Ces nouveaux objets architecturaux dans la capitale française poursuivaient une certaine forme de tradition, notamment avec la Tour Eiffel, l’Opéra Garnier, le Grand Palais, etc. Si les gabarits tenus et l’unité sont réservés aux artères haussmanniennes, les monuments célibataires, quant à eux, viennent clore ces grandes percées au milieu de vastes places.
N’oublions pas l’axe historique dessiné par le jardinier du roi Louis XIV, André Le Nôtre. Du Louvre au château de Saint-Germain-en-Laye, une perspective va se mettre en place pendant plus de trois siècles. La Grande Arche de la Défense en fut une étape des plus passionnante, tant du point de vue symbolique, qu’urbanistique et architectural.
Une écrivaine de romans a toujours admiré la Grande Arche pour ces trois lignes de force, intriguée a posteriori par le peu de littérature autour de son architecte, elle décide de mener l’enquête auprès des témoins encore vivants. Car seul manque à l’appel l’architecte, un comble !
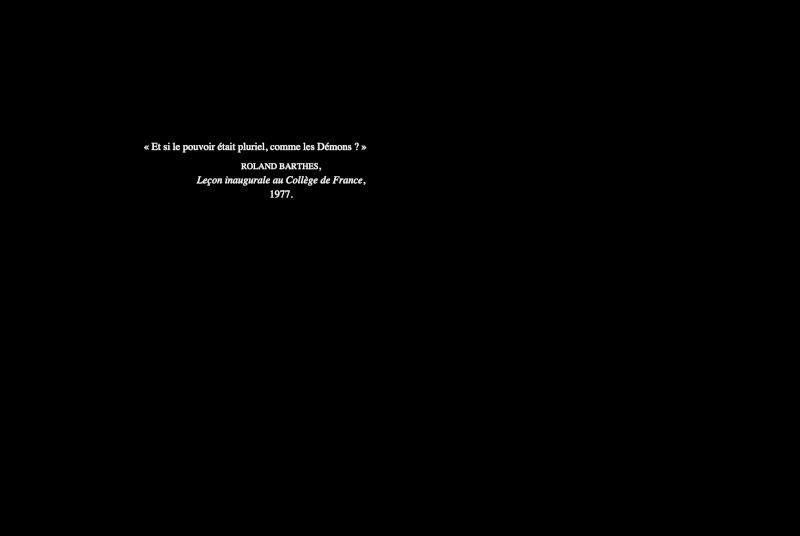
Laurence Cossé mène l’enquête en sculptrice de caractères
L’autrice a appelé son ouvrage « Roman », ce qui est étonnant, détonnant comme dirait Desproges. Lorsque vous refermez la dernière page vous comprenez cependant pourquoi. Tant de personnes réelles apparaissent telles des personnages romanesques ; il faut dire que cette histoire de la construction de l’Arche à la Défense se distingue par son indéniable force romantique et le destin tragique de l’architecte danois Johan Otto von Spreckelsen.
Pour celles et ceux qui ont lu l’ouvrage il y a presque maintenant dix ans (Gallimard, janvier 2016), le plaisir d’une relecture à l’aube de la sortie du film inspiré par ce dernier s’impose. « L’inconnu de la grande arche » de Stéphane Demoustier, en salle à partir du 5 novembre, semble s’intéresser aux relations entre le Prince et l’Architecte. Logique. Vieille histoire dont les grands fracas ont balisé l’histoire de l’architecture mondiale. À quelques exceptions, les chefs-d’œuvre architecturaux sortent de terre grâce ou à cause de l’entente cordiale ou passionnée entre deux démiurges.
À ce titre, et au vu des circonstances, Laurence Cossé a eu la bonne idée de diviser en deux grandes parties les cinquante-cinq chapitres qu’elle consacre à la gloire spontanée de l’architecte, puis à sa perte malheureuse.
En deux parties « Ce jour-là, nous étions heureux » et « I-gnoble », nous savons tout ce qui est possible de connaître sur la logique d’acteurs et le processus de projet – public – à la française. L’autrice mène l’enquête comme un véritable détective privé ou pour le dire mieux, une anthropologue ; dans sa deuxième acception du Petit Robert, pour être plus précis, à savoir « Ensemble des sciences qui étudient l’être humain en société. »
À chaque rencontre, un portrait est dressé avec un souci du détail, comme si la romancière sculptait des drapés de marbre. Avec une pointe d’humour ou, à de rares exceptions, un sarcasme larvé, la personne rencontrée est littéralement scannée, rien ne lui échappe.
De fait, la visite chez nos confrères Jean-François Pousse et François Chaslin sont exemplaires. Laurence Cossé décrit avec minutie le logement dans lequel elle est accueillie par son hôte. L’histoire de la poule « Cocotte » chez le premier et le bazar organisé chez le défunt second ne manque pas de joyeuseté. Cela devient amusant lorsqu’elle note les similitudes vestimentaires et de chevelure chez ces deux compères de la critique architecturale.
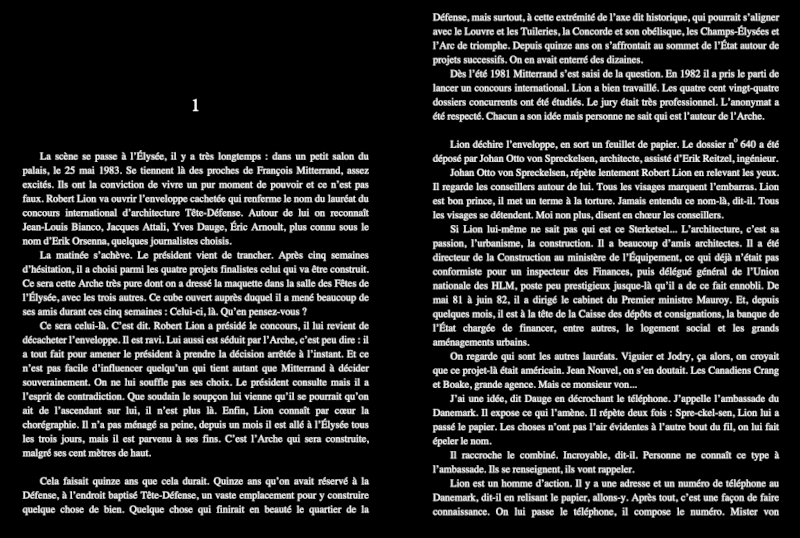
Un architecte romantique comme nous les aimons
La grande histoire, l’angle mort de son récit extrêmement documenté n’en demeure la tentative de comprendre la vie et le talent de cet architecte mystérieux que fut Spreck. Sur ce diminutif, l’autrice n’hésite pas à interrompre sa narration afin d’expliquer pourquoi, dans certaines phrases, elle utilise le nom dans son entièreté – Johan Otto von Spreckelsen – quant à d’autres endroits elle convoque le diminutif Spreck. Comme toute esthète littéraire, elle cherche la musicalité de chaque phrase, les deux dénominations possibles sont à son service.
Totalement inconnu au moment du dépouillement du concours et de la prononciation difficile de son nom, Spreckelsen avait dessiné et construit, brique par brique avec ses artisans comme aime à le dire si bien Laurence Cossé, quatre églises dans son pays natal.
Nous étions à l’époque bénie des concours ouverts où l’anonymat régnait encore et la surprise était de mise, pour le meilleur et le pire. À vous de voir selon les neuf projets cités en introduction. Ici l’esquisse, la simple esquisse faite à la main d’un hypercube monumental en contreplongée fit son effet et remporta la mise. Les membres du jury, parmi lesquels Richard Rogers et Richard Meier, avaient admirablement bien saisi l’importance d’édifier une forme simple, qui plus est ouverte, dans un chaos de tours les plus laides les unes que les autres. Notons que depuis l’implantation de la Grande Arche, les nouvelles tours ont gagné en rendu plastique et s’équilibrent plus ou moins bien de chaque côté du monument, notamment du point de vue de l’Arc de triomphe. L’apport urbaniste du cube est indéniable
Mais pourquoi notre architecte danois a démissionné sur un coup de tête après une visite de chantier ?
Laurence Cossé tente d’y répondre en se rendant au Danemark afin de rencontrer sa veuve, visiter ses églises et essayer de comprendre le caractère de cet homme à l’élégance tranquille. L’histoire qu’elle nous narre est dès plus romantique. D’un romantisme tragique quant à sa fin puisque JOS décède six mois après avoir donné sa démission…
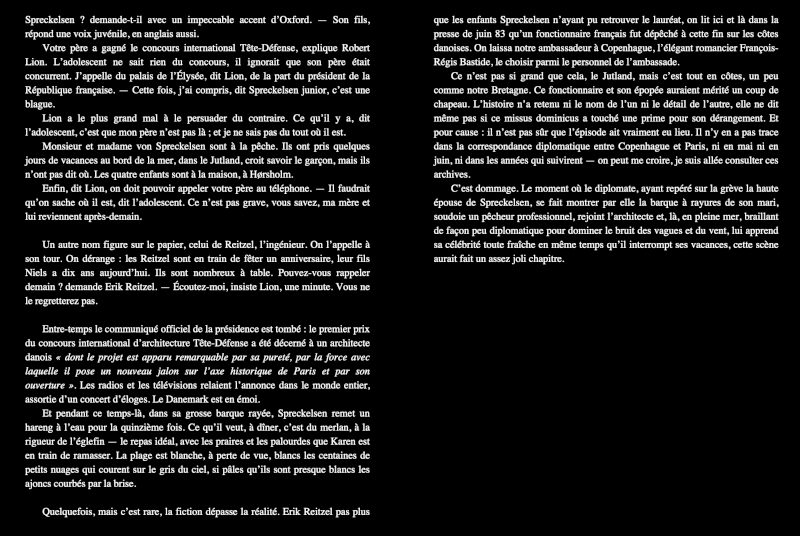
Pièces à conviction pour une affaire tellement française
P148, Première phrase du chapitre 25 : « On avance et l’Arche s’enfonce. C’est le résumé de l’histoire telle que Spreckelsen l’a vécue. J’imagine », raconte l’auteure.
Il est clair que la situation politique française n’était pas glorieuse en 1986 ; la cohabitation brillait de mille feux, Chirac tentait par tous les moyens de stopper ou liquider l’ensemble des grands projets de Mitterrand. De bonne guerre ? Laurence Cossé explique que vue de l’extérieur, surtout du Danemark, les choses paraissent complètement folles. Pourquoi vouloir à tout prix briser ce que le Président en activité, mais sans gouvernement, souhaite faire aboutir pour l’intérêt général ? Un projet comme l’Arche ayant fait l’unanimité quant à son implantation urbanistique dans un quartier d’affaires dès plus douteux architecturalement, exclusivement réservé à la boulimie néfaste des promoteurs immobiliers qui ne pensent jamais architecture, juste construire des m² pour un maximum de rentabilité numéraire. Et pourtant l’histoire dit que c’est un promoteur et un maçon qui sont venus à la rescousse de l’hypercube. Je n’en dis pas plus, à vous de lire ou relire l’excellent livre de Laurence Cossé avant de vous installer confortablement dans un fauteuil d’une salle obscure pour visionner « L’inconnu de la grande arche ».
Christophe Le Gac
Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde