
Yannick Haenel et Aurélien Bellanger racontent leur expérience d’une nuit passée dans un musée, respectivement le Centre Pompidou et Le Louvre. Comment est-il possible de passer une nuit, seul, dans un musée ? D’y interroger l’art de l’écriture en même temps que celui de la peinture ? Les mots, l’esprit, la vue, le corps, les fantômes, l’espace y seraient au travail. Chronique de l’avant-garde.
Depuis 2018, Alina Gurdiel a lancé une collection aux éditions Stock au nom explicite de « Ma nuit au musée ».* Le titre en indique sa dimension personnelle et intime. Une personne doit passer une nuit dans un musée habituellement fermé et dédié aux publics. La rencontre entre l’art et l’architecture des lieux et l’écriture est à son comble.
L’écrivain des intensités – Yannick Haenel – au style épique, flamboyant et profondément poétique, délire totalement fasse aux toiles du peintre irlandais Francis Bacon (Bacon en toutes lettres, de septembre 2019 à fin janvier 2020).
Aurélien Bellanger est souvent moqué pour son style Wikipédia. La plupart des commentateurs n’y comprennent rien car si vous lisez Bellanger, vous sentirez cette passion balzacienne de la description, rehaussée d’une poésie du verbe, l’ensemble, toujours extrêmement documenté, à thèse en quelque sorte.

Yannick Haenel en mal de Bacon
Dès les premières lignes, nous sentons l’auteur fébrile : « La lumière était aveuglante, des néons écrasaient les tableaux qui, tout autour de moi, s’échangeaient des reflets ». L’auteur indique de suite comment il se sent affecté, impacté, à la fois par l’accrochage des œuvres du peintre, et par les salles dans lesquelles elles sont situées.
Aujourd’hui les obligations de sécurité et de conservation des tableaux exigent une mise sous verre récurrente des œuvres. Bacon le faisait pour une autre raison, il sentait le besoin de mettre à distance le regardeur, ainsi ce dernier pouvait comprendre l’unité du tableau et le prendre de plein fouet. Yannick Haenel en a fait les frais. Une migraine l’a rendu aveugle pendant quelque temps. Un comble pour quelqu’un dont le rêve était de passer une nuit parmi les toiles d’un de ses peintres préférés. Là, nous sommes dans l’essence de l’œuvre de l’écrivain. Si vous avez déjà lu un de ses romans – Tiens ferme ta couronne (2017, chez Gallimard), par exemple –, vous savez à quel point son double littéraire subit une suite de catastrophes et d’aventures rocambolesques.
Quoi de mieux qu’un mal de crâne pour délirer ses années de jeunesse passée dans une chambre africaine et la rencontre d’un espèce de sorcier qui lui aurait lancé des sortilèges. L’espace restreint de la chambre où tout se dévoile comme un écho aux couches de couleurs contenues dans l’univers de Bacon, celles-ci souvent tenues dans un volume cubique déformé et réduit aux seules arêtes filaires qui le délimitent.

Après avoir retrouvé la vue, Yannick délivre son sentiment d’ivresse devant les tableaux : « Quand on regarde de la peinture, les repères glissent et l’espace se libère, c’est pourquoi on se sent si bien ». L’auteur consacre tout un chapitre où il décrit sa course frénétique dans les espaces du Centre Pompidou, « mort de rire », les mots racontent la joie et l’extase de la peinture qui déborde et devient un lieu à part entière. Situé au tiers du texte, cette partie en constitue son sommet. Pourquoi ? Car sur dix pages, en une seule phrase, Yannick Haenel réussit la prouesse d’embarquer le lecteur avec lui dans ses visions physiques et mentales de l’œuvre de Francis Bacon. Extraordinaire, il n’a rien à envier à Marcel Proust.
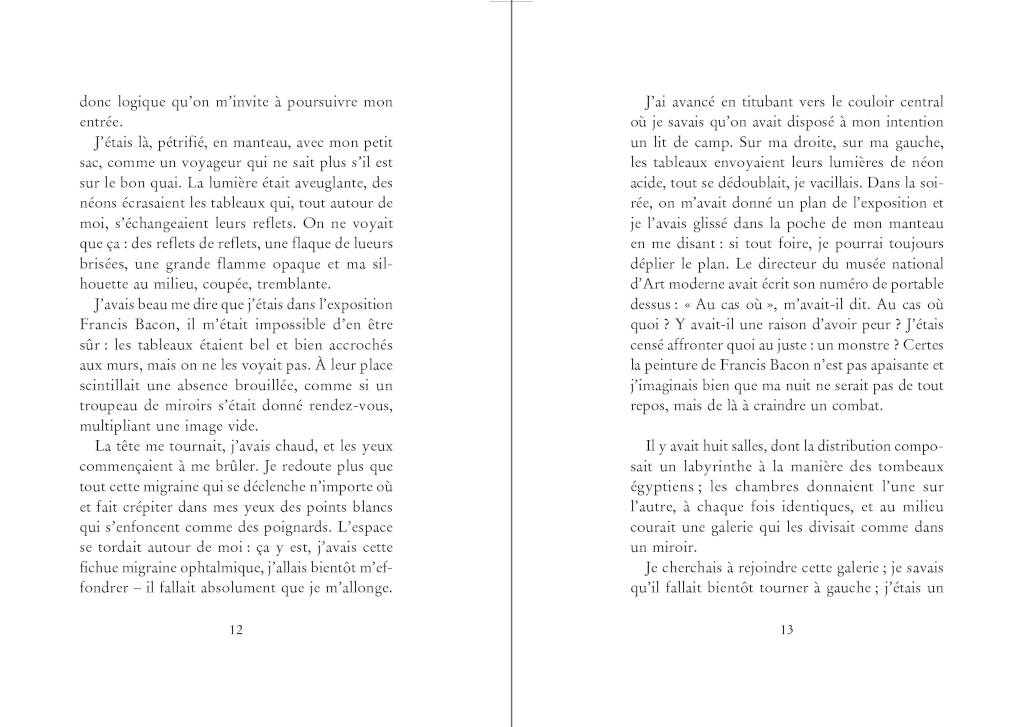
« Ainsi en va-t-il de l’ambiguïté même de la littérature, qui ne fait qu’ajuster un monde de phrases mais prétend par ces phrases éclairer celui où l’on vit ». Tout est dit quant à la pensée de l’auteur sur l’acte même d’écrire et de son rapport au monde.
Une dernière péripétie va conduire notre ami l’écrivain à délirer, à nous inciter à sentir et expérimenter la peinture en fonction du (non)-lieu dans lequel elle est montrée, et, comment cet environnement vous incite à penser… la finitude et l’étendue des choses, des êtres, de l’art, etc. la pensée spinoziste n’est jamais loin.

Aurélien Bellanger à la recherche d’un romantisme classique
Quant à Aurélien Bellanger, nous le suivons au Louvre, dans un moment de régression provoqué par sa nuit au musée. Une nuit dans la salle des « Quatre Saisons » de Poussin lui aura rappelé à quel point la jeunesse n’est pas une période si facile dans la construction de son histoire. A la différence de son illustre aîné, il a choisi de raconter cette période d’apprentissage où le monde est devant vous, à conquérir, tel un Rastignac à la Balzac ou un Georges Duroy à la Maupassant. Si l’auteur ne cite pas ce dernier, le premier plane assurément sur l’ensemble des écrits. Roman, autobiographie, essai, difficile de situer la nature du texte à lire. Aurélien Bellanger se distingue de ses consœurs et confrères par son habitude à brouiller les cartes. Depuis son premier « roman » – La théorie de l’information (2012, Gallimard) -, il aime multiplier les pistes entre le récit fiction, la narration romanesque et l’étude universitaire extrêmement documentée, et réussi à tenir cet ensemble dans une prose limpide, dynamique et nappée de moments exaltés, voir lyriques.

Enfermé dans cette immense bâtisse du Louvre, le romancier cherche à se rappeler les œuvres de jeunesse de Nicolas Poussin. Eminent représentant de la peinture classique du XVIIe siècle, ce natif des Andelys (hameau de Villers), aura atteint un niveau d’ordre dans la composition, de justesse du trait, où l’importance de la ligne et le soin particulier à l’incarnation de paysages antiques sont en diapason. Poussin emmène la peinture au point d’acmé de la perfection de l’art classique occidental, à savoir, la raison guidant la main sûre du peintre.
L’écrivain s’aperçoit qu’il existe peut ou pas d’informations sur la jeunesse du peintre. Fort de ce constat, il s’empresse d’utiliser cette anomalie pour décrire sa jeunesse, celle du temps où il avait des velléités à devenir un artiste. Pendant plus d’une année, il ne se déplace jamais sans un caméscope à la main. « Au moment d’entrer au Louvre, (…), je venais de retrouver le journal vidéo que j’avais tourné vingt-ans plus tôt en arrivant à Paris », dit-il. Tout le long de Le musée de la jeunesse, Aurélien Bellanger raconte ses années de formation, les espaces dans lesquels il vit avec des compagnons de route de circonstance, ses aventures de cœur, et le milieu socioéconomique, culturel et intellectuel qui verra naître son désir d’écriture. Devenu un auteur accompli, il nous livre plusieurs secrets intimes et insiste sur les mécaniques à l’œuvre dans cette quête très balzacienne d’embrasser le monde afin de le dompter par son accomplissement personnel.
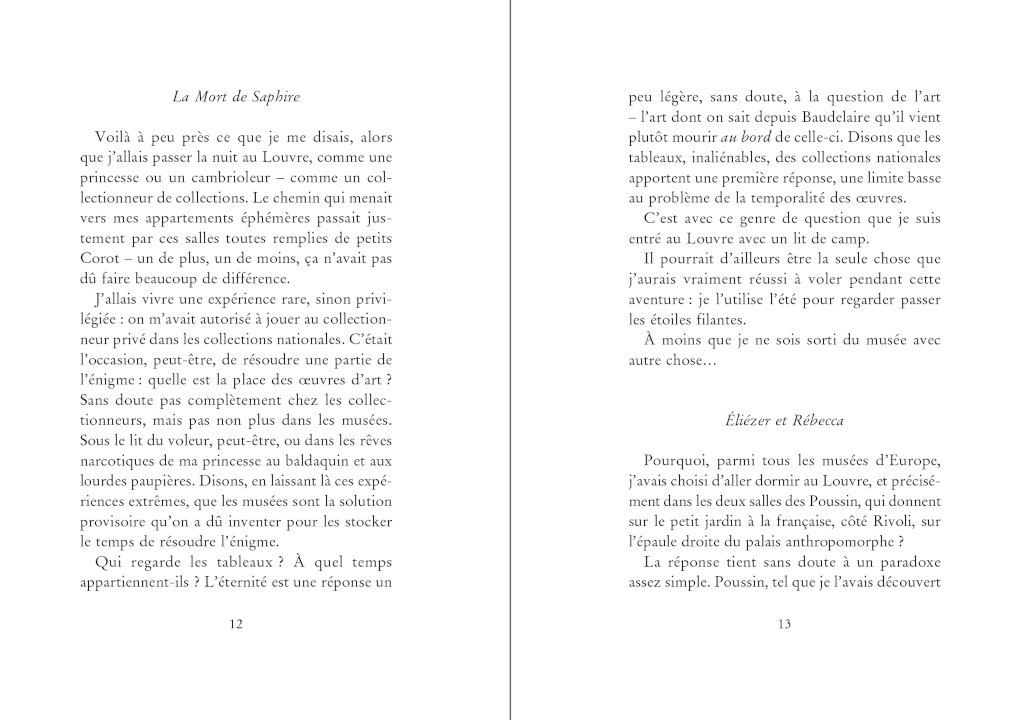
Voir dans un musée, tout un art !
Une fois les deux livres refermés, plusieurs pensées traversent l’esprit… L’une d’elles persiste : visiter un musée n’est pas de tout repos ! Les yeux doivent se battre avec la peinture et avec le corps chez Yannick Haenel. Chez Aurélien Bellanger, les souvenirs de jeunesse prennent le pas sur le temps vécu dans une salle consacrée à l’œuvre de Nicolas Poussin. Comme le dit celui qui a passé du temps sur un lit de camp à regarder des grands tableaux classiques, tout en repensant au temps où il voulait devenir artiste : « Qui regarde les tableaux ? A quel temps appartiennent-ils ? L’éternité est une réponse un peu légère, sans doute, à la question de l’art – l’art dont on sait depuis Baudelaire qu’il vient plutôt mourir au bord de celle-ci ».
Néanmoins, une constance : les artistes passent, les œuvres restent !
Nous pouvons dire à la suite de Malraux et Gilles Deleuze que l’art résiste à la mort. Pour preuve, des écrivains y passent des nuits entières à méditer sur leur art tout en regardant celui qui les entoure.
Christophe Le Gac
Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde
* Collection « Ma nuit au musée » – Éditions Stock
Bleu Bacon par Yannick Haenel
Le musée de la jeunesse par Aurélien Bellanger
https://www.editions-stock.fr/livres-ma-nuit-au-musee/