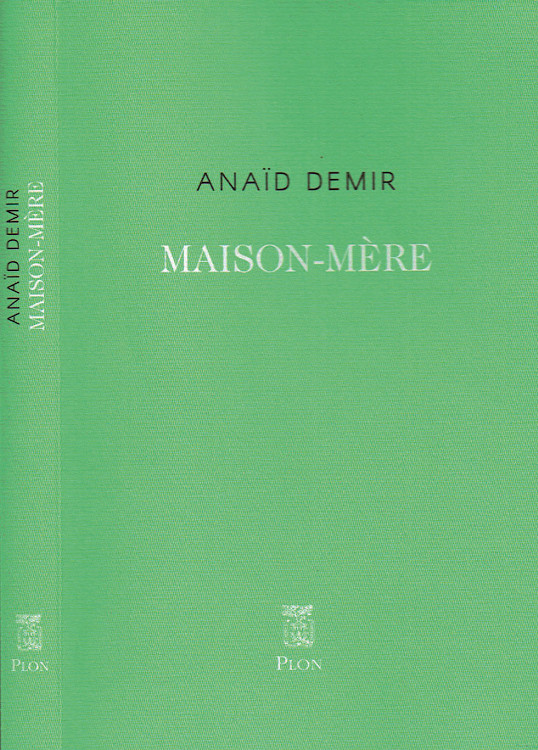Dans l’ouvrage Maison-Mère (Plon, 2022), la critique d’art Anaïd Demir est obligée de revenir dans la maison qui l’aura vue grandir. Arrivée dans cette demeure dont les souvenirs sont les seuls habitants, l’auteure se plonge dans une solitude volontaire. Telle une enquêtrice en quête de preuves sur le passé familial, Anaïd offre à ses lecteurs la radiographie d’un pavillon de banlieue bien étrange à certains égards.
Retour au bercail
Tout commence par une obligation. Après le décès de ses parents, alors que se pose la question de l’héritage, l’auteure se retrouve avec un pavillon de banlieue en meulière sous le bras. Enfin, plus exactement à devoir habiter de nouveau dans une demeure qu’elle a fuie depuis son indépendance. Elle doit quitter l’intra-muros pour redécouvrir les joies et les tracas des déplacements ferroviaires entre Banlieue et Paris, Paris et Banlieue.
Critique d’art bien connue du milieu, toujours sur le qui-vive, au parlé franc, Anaïd Demir est une Parisienne qui aime les rues de la capitale, ses cafés, ses clubs, ses galeries, etc. Ne pouvant plus payer le loyer de son deux-pièces, elle décide de retourner dans cette maison. « Intense et glaçante, elle m’agrippe du regard. Imperturbable, elle a déjà englouti la plupart de ceux qui l’ont habitée. Et maintenant ce serait à mon tour ? » Voilà comment elle envisage le retour au bercail.
Anaïd Demir en anthropologue de ses souvenirs spatio-temporels
Chaque espace décrit par la narratrice est à l’image de la description de la Pension de Mme. Vauquer dans Le père Goriot (1835) de Balzac. Aspirés par le flux de détails sur le moindre objet, papier peint, ou rayon de soleil sculptant l’espace dans lequel se trouve l’occupante, le lecteur a l’impression de se glisser dans la peau de l’auteure, à la manière du marionnettiste dans le film Dans la peau de Malkovich (Beeing John Malkovich, 1999), de Spike Jonze.
A partir de cette perspective, Anaïd Demir revisite la maison de banlieue familiale comme une anthropologue, chaque pièce passée au peigne fin. Devenue l’enquêteuse de son histoire et de sa famille proche, Anaïd est guidée par la quête d’une photographie de sa mère en jeune femme moderne, épanouie, non encore mariée. Avec appétit, nous suivons cette apprentie détective dans les nombreuses pièces de la demeure.
Les titres de chapitre du livre sont à eux seuls une géographie des lieux, un voyage entre moments de vie, visions d’un passé toujours présent et ‘physicalité’ des espaces construits.
« Retour à la case départ / Maison de ville – Vue extérieure » ; « Silence / Antichambre » ; « Berceau originel / Pouponnière » ; « Philharmonie linguistique / Chambre d’enfant » ; « Nirvana aquatique / Salle bains » ; « Week-end en famille / Salle de séjour » ; « Chantier en cours / Colombier » ; « Muséum d’histoire personnelle antre de Yaya » ; « Sonorité / Chambre de ma sœur » ; « Une vie sur-mesure / Atelier » ; « Recettes du bonheur / Cuisine » ; « Le jardin d’Eden / Cour arborée » ; « Le clan des Ciliciens / Chambre des garçons » ; « Un père en or / Grenier » ; « La photographie / Suite nuptiale » ; « Tréfonds / Cave » ; « Maison-Mère / Vue aérienne ».
Tel un poème, ces titres et sous-titres permettent de se faire une projection volumétrique des espaces de vie de cette maison vue par l’auteure comme un château gothique du XIIe siècle. Nous ne savons vraiment jamais de quel style et de quelle époque est cette bâtisse, c’est tant mieux. En revanche, la dimension domestique est à l’œuvre dans chaque description. La maison est vide mais respire la vie. Les mots choisis traduisent bien l’expression suivante : « On n’a l’impression d’y être ».
Cette liste ouvre aussi de nombreux indices sur l’héritage familial quant à ses origines ethniques.
Un livre d’histoire
Au-delà de l’analyse phénoménologique de l’habitat, Maison-Mère est aussi une belle porte d’entrée dans l’histoire souvent oubliée par l’Occident, certainement par peur des représailles des différents gouvernements turc plus lâches les uns que les autres à propos d’une des nombreuses pages peu reluisantes de leur histoire, à savoir la tentative d’éradiquer le peuple arménien, tout aussi légitime que le peuple turc ou kurde à vivre sur ces terres à l’intersection entre l’Occident et l’Orient.
Demir fait preuve d’un savoir historique qu’elle partage avec une syntaxe très informée et didactique. Prenons l’exemple de l’alphabet : (…) de trente-huit lettres qui nous était propre et qui datait de 405. On le devait à un certain moine Mesrop Machtots. (…) Il crée aussi l’alphabet des voisins géorgiens en 411, et enfin celui des Albaniens en 420 » (Pas ceux d’Albanie mais d’un peuple en Caucase).
Elle se permet même de s’abandonner dans des entrelacs textuels émouvants quand elle se souvient d’utiliser toujours de l’encre turquoise dans ses stylos-plumes pour écrire sur ses cahiers scolaires : « Partout, je tricote des lianes de mots sans faire de lien entre cette couleur et mes origines. D’Arménie en Turquie et de Turquie en turquoise, je vogue sur la Méditerranée ».
L’experte de la Maison-Mère
« Depuis mon retour, c’est cette baraque qui décide pour moi. Quelle séquence va-t-elle me faire revivre cette fois ? Elle me projette sans cesse en arrière. J’erre ici et là, désespérément à la recherche d’une issue. Sans jamais réussir à vivre au présent ni accéder à mon avenir. Une spirale sans fin ».
Anaïd Demir écrit, décrit, une immersion dans un passé qui redevient du présent et interroge le futur. Comme elle l’écrit vers la fin du roman : « Disposer d’un trousseau de clefs ne suffit pas à disposer d’un lieu ».
Même si sa plume fluide lui a permis d’écrire un récit fictionnel extrêmement documenté sur sa famille d’Arméniens de Turquie devenue française dans les années 1960, implantée à 30 kilomètres de la capitale, et avec pour principale qualité cette aisance à nous faire toucher du doigt la ‘physicalité’ des lieux habités, les fantômes ne s’en laissent pas conter ; ils ne sont pas prêts à lâcher l’affaire.
Partir reste la seule ligne de fuite possible, non ?
Christophe Le Gac
Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde