
L’architecture doit rester la discipline performante et majeure qu’elle était, encore dernièrement, juste avant qu’elle ne soit mise, imprudemment, entre les mains « d’habiles blagueurs ».
Dans quelques semaines, le MIPIM, le grand salon international de l’immobilier va voir déambuler à Cannes le petit peuple des architectes venu ramasser les miettes du festin organisé par les faiseurs de villes immobiles aux accents écologiques apocryphes. On y parlera davantage de foncier, de rendement de plans, de retour sur investissement et de dégâts économiques issus de la dernière RT, que d’architecture, d’espace, de fluidité, de mobilité, d’écologie critique ou de valeur réelle du coût de construction.
Dans une période secouée par des décisions qui se prennent au rythme des dépêches numériques et qui change ses repères à la vitesse de tous ces bouts de saisons décousues, on peut se demander de quelle architecture vraiment on parle ?
En ce qui me concerne, je la vois surtout, dans cette période à la fois de surconsommation et de remise en question de nos politiques sociales, comme plus utile que flamboyante.
Je veux parler, à la fois, de ce caractère qui contredit la dimension indifférente de ceux qui n’imaginent l’architecture qu’à travers sa dimension exceptionnelle et de cette qualité qui harmonise ses contenus ordinaires avec les récits de l’auteur, mais en en se distinguant toutefois de ces constructions récentes, frappées d’ankyloses.
Dans le cadre de ces architectures domestiques qui me sont chères, je reste plutôt attaché à tous les cas particuliers qui fabriquent des architectures pertinentes. Beaucoup moins à l’idée du « même plan pour tout le monde » qu’on essaye de nous imposer, un peu plus, chaque jour, comme si nous n’étions plus les seuls dépositaires de l’espace construit.
Les architectes, soumis à l’autocratie du rendement et à une intelligence artificielle dont ils n’ont pas encore vu arriver la portée marchande, régressent, un peu plus tous les jours, devant les entreprises et les marchands de biens qui ont mis les moyens pour s’en débarrasser, chaque fois que les élus ou les édiles appuient un peu plus sur la chimère d’une architecture responsable dans leurs communes.
Ce ne serait donc qu’une question de réaction ?
Imaginait-on, il y a quelques temps encore, des professeurs en médecine et des chirurgiens quitter le navire-hôpital parce que mis dans l’incapacité d’exercer leur discipline normalement ? Pourtant, ils l’ont fait. Comme eux, les architectes vont-ils jeter leurs manteaux noirs et leurs certificats attestant qu’ils ont prêté serment, aux pieds du ministre de la Culture et du ministre des Territoires ? j’en doute.
Il y a pire : l’architecture est passée tout récemment (la loi ELAN y est pour beaucoup) entre les mains de ceux qui n’étaient censés qu’en diriger les travaux. Tout se juge désormais sur des valeurs financières, recensées sous hypnose des tableaux Excel et catalepsie de plans d’amortissement. En dehors de trop rares résistants, une obéissance par consentement est fortement suggérée à l’entrée.
Le budget et le délai ont remplacé le projet d’architecture et ses destinataires. L’architecture, tout le monde s’en fout. « Faut aller vite, les gars : les fonds d’pensions s’impatientent ».
Rajoutez-y une dose de juridique, une dose d’économie responsable, une VEFA (vente en état futur d’achèvement), un passage chez Truffaut et une soirée chez les bio-ressourcés, et vous verrez que « l’architecture, au fond, c’n’est pas si compliqué qu’ça ».
Vous comprenez alors la difficulté à réaliser, dans la cité et pour longtemps, une œuvre complète, stable et homogène, cohérente et exigée.
« L’architecture n’est plus un art de composition, c’est un art d’assemblage », soutient l’architecte Anne Démians, soulignant que c’est seulement par l’assemblage des contraintes que nous pouvons atteindre désormais quelque chose d’important. Cela, bien sûr, en dehors du champ des grandes compositions graphiques ou déjantées du moment. Rudy Ricciotti, lui, place l’architecture dans le registre « des sports de combat » et Marc Barani la voit toujours comme « la science des correspondances subtiles ».
C’est dire à quel point il devient difficile d’exercer notre art de « jouer d’assemblages subtils dans le cadre d’un tel sport ».
Qu’il s’agisse du Ministère de la Culture (les Bons Enfants), des logements de la Rue Durkheim, de l’opération immobilière de la Place de la Porte d’Auteuil à Paris, de la Maison du Numérique à Sarcelles, du Centre R&D/EDF à Saclay, le Pont sur l’Arno à Florence ou de l’Embankment de Songjeong à Séoul, chacune de mes réalisations a nécessité une attention quasi permanente et une proximité renforcée pour ne pas les « laisser filer » en dehors des valeurs fondamentales qui les avaient construites.
Prenons l’exemple du Centre R&D/ EDF à Paris Saclay. Il fut entièrement pensé et réalisé avec l’objectif d’en faire « un ouvrage efficace, durable et élégant » répondant aux préoccupations du moment (carbone, énergie, recyclabilité, équilibre vert) sans jamais manquer à ses obligations énergétiques et écologiques, définies et développées en dehors de toutes les prescriptions prémâchées dont on nous abreuve (RT, Cerqual, Leed, Breeam, BBC, HQE, Effinergie, matériaux biosourcés).
Cette œuvre pourtant récente (2016) ne pourrait plus voir le jour quatre ans plus tard. A la vitesse où se défont les fondamentaux, je suis convaincu que les instructeurs, tous issus des écoles d’éloquence, l’auraient déjà sacrifiée au nom de l’économie indispensable de sa syntaxe.
Car c’est bien sur ces valeurs fondamentales (qui n’appartiennent qu’à un auteur) que se construit l’architecte moderne. Souvent déchiré entre le choix de signes distinctifs et d’une mise à disposition de l’ensemble de ses compétences, il hésite.
Aussi, au style d’un architecte, on préférera sa disponibilité.
Car le style, c’est cette « façon de faire » qui permet d‘identifier immédiatement un auteur à travers ce qu’il a dessiné ou ce qu’il a construit. Et qui s’impose quel que soit le projet qui lui est proposé. C’est comme une marque de fabrique qui acte l’identité de l’auteur avant même que la pertinence de l’objet ne soit démontrée.
Si l’architecture s’était appliquée à elle-même la réforme systémique à laquelle les transformations de la fin du XXe siècle auraient dû logiquement la conduire, nous aurions pu acter que le style en architecture aurait alors été remplacé par la réincarnation d’une forme moderne de la Renaissance.
Et cela pour tous les architectes visant à plus d’intelligence de projet. Posture qui reste toutefois une voie de recyclage qui évite à l’architecte de sombrer dans le réflexe imprudent de « l’autosatisfaction frénétique et destructrice » ou celle de l’acceptation « des produits imposés »
En effet, il suffit d’observer le phénomène quasi viral de la construction bois pour avoir l’image de la situation grotesque dans laquelle nous sommes plongés. En dépit de toutes ses contraintes restrictives, ce lobbying n’est rien d’autre qu’un refrain partagé par des tacticiens de l’écologie de bazar et des architectes dépourvus d’anticipation, s’emparant du discours ambiant, juste pour plaire.
Si tout cela ne vise qu’à capter l’attention de commanditaires démunis sur le plan de l’objectivation de la ville et de l’architecture, on peut penser que, rien qu’avec un tel phénomène, l’architecture est en grande difficulté.
La disponibilité, en revanche, est cet état qui met les architectes en capacité de réfléchir de manière globale, plus synthétique. Mixer plusieurs disciplines et plusieurs outils, au lieu de rester bloqués dans ces spécialités dans lesquelles on les enferme : les architectes qui s’en sortiront sont ceux qui multiplieront les paramètres d’action pour peser sur la construction. Précisément sur les terrains où « les autres » ne sont pas.
Car être architecte aujourd’hui, c’est être capable, devant une feuille blanche, ou confronté à un BIM qui appauvrit et régule le vocabulaire de l’architecture, de partir de rien qui soit répertorié. Or, tout avance et s’atteste aujourd’hui sans expertise.
La bataille du bois contre le béton ou l’acier n’est pas un sujet de société. C’est seulement une conversation d’individus qui n’ont rien à voir avec l’architecture. Rien qui ne fasse l’objet d’une démonstration solide, qui présente des preuves critiques de ce qui est avancé, à l’exception peut-être de celles que nous vivons sûrement, en dehors de toute approximation se prétendant savante.
Peut-on sortir des modes constructifs et des cahiers des charges émargés en pourcentage par les promoteurs ? Certainement. Mais en les dénonçant ouvertement et en faisant prévaloir le bon sens sur les effets d’annonce.
Une preuve en est donnée Rue Campagne première où j’achève la construction de 99 appartements privés et de 34 logements sociaux pour le compte de COGEDIM et de la POSTE. Bilan vérifié : certifications et réglementations atteintes, valeurs BBC et Bas carbone obtenues, dans une configuration 0% bois.
J’ai évité le bois, les plantes vertes et les jetées de rhubarbe. Cela m’a permis d’apporter une vraie consistance à cette opération et de lui donner une vraie chance de survivre aux pluies acides et aux particules fines qui mettent en danger tous les corps putrescibles ou poreux. Mais aussi, et surtout, de m’autoriser à affirmer que s’inscrire dans l’histoire particulière d’une ville est, en priorité, s’en inspirer.
C’est certain, si je construisais en Norvège, je choisirais le bois. Mais certainement pas à Paris, ville minérale, faite de pierre et d’acier.
Aussi, la dernière question que nous serions en droit de nous poser vraiment maintenant serait la suivante : l’architecture peut-elle exister loin de toutes les manipulations industrielles et politiques de l’opinion qui prétendent sauver la planète sans jamais apporter la moindre preuve de leur efficacité ?
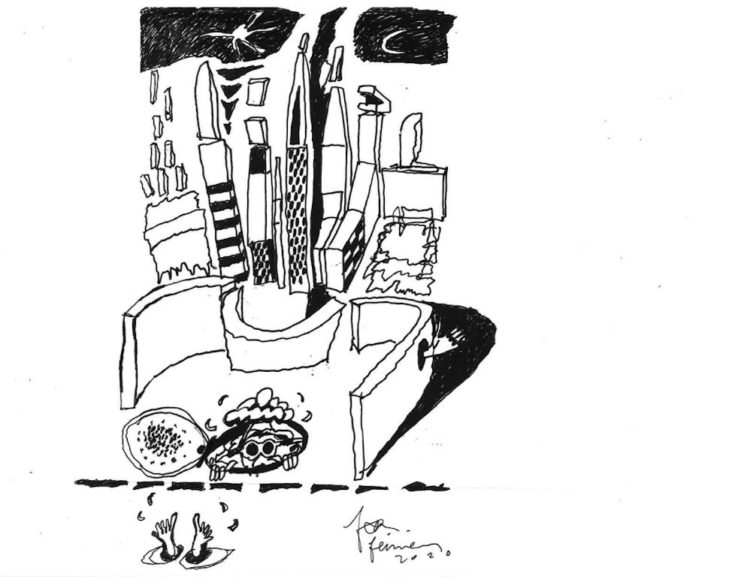
Rembobinons le film.
Dans les années 80, le maître-mot en architecture était l’immatérialité. Cette pensée est née en grande partie grâce à l’utilisation des techniques souples que nous avions à disposition.
On luttait tous, alors, contre l’apparence d’une pesanteur obsédante qui s’abattait sur nos projets d’immeubles qui, massifs, ne restituaient aucun des signes de légèreté que nous cherchions.
La Pyramide du Louvre ou la Maison des sciences et de l’homme (boulevard Raspail) en sont des exemples parfaits. Les espaces, les structures ou les façades, à connotation industrielle, mais si intelligemment dessinés, contribuent à cette immatérialité qui se différencie de la matérialité instantanément visible des ouvrages lourds.
Interrogé dernièrement sur l’avenir des villes et de l’architecture, ma réponse fut simple : « Supprimez la subjectivité démiurgique de ceux qui dirigent nos agglomérations, le foncier et le clientélisme, vous aurez, tout de suite, la solution ».
Ces édiles dont on dit qu’ils ont, pour nous, des projets sociaux, culturels ou économiques, naviguent au gré de l’opinion et d’alliances passées pour gouverner leur territoire. La ville utile et opérationnelle n’est pas une vraie question pour eux.
Hier, on évoquait la voiture, le footing, les grands aménagements urbains, les équilibres sociaux ou l’architecture. Aujourd’hui, on parle climat, bois, carbone, forêts urbaines, pollution, pistes cyclables et santé. Et demain, on mettra probablement en scène une dématérialisation ultra rapide de l’espace urbain, dont la nature renverra au placard tout ce qui nous est fourni, tout de suite, au nom de la réparation salutaire.
Que restera-t-il alors de l’identité de l’individu moderne, historiquement incarnée par la transformation matérielle de la pensée par l’architecture ?
Le vélo ?
Francis Soler
Paris, février 2020