
Le collectif French Touch aurait eu dix ans cette année. L’aventure a pourtant cessé après sept années de débats, de fêtes, d’éditions et de polémiques. «Sept ans, le temps de l’amour», ironise Gaëlle Hamonic. Sept ans pour se donner «les moyens de faire», de réfléchir sur la fabrique de la ville alors que dehors, le petit monde de l’architecture et celui de sa communication prenaient un virage bien serré. Grâce ou à cause de la French Touch ? Rencontre animée avec quelques-uns de ses fondateurs.
Comme au bon vieux temps, Julien Zanassi (Atelier Philéas), Nicolas Ziesel (Koz Architectes), David Trottin (Périphériques architectes) et Gaëlle Hamonic (Hamonic+Masson) se sont retrouvés à l’invitation de Chroniques d’architecture pour un retour sur le parcours d’un collectif plus bruyant que les autres. Que reste-il de l’aventure ? La French Touch se voulait critique quant à l’évolution de la commande et du métier d’architecte, avec le temps, l’architecture est-elle encore optimiste ?
Aux sources de la French Touch, il y a en 2007 une prise de position radicale contre le Prix de l’Equerre d’Argent, attribué cette année-là à Nathalie Franck et Yves Ballot pour la restructuration-extension d’un groupe scolaire à Bordeaux alors même qu’il y avait de sérieux concurrents parmi les finalistes.* «Entre un grand geste architectural et une architecture du quotidien, le jury a choisi l’architecture du quotidien», avait expliqué Le Moniteur. Bientôt, plus de 120 architectes signaient une pétition s’élevant contre «la manipulation réactionnaire qui vise à vider de son sens la complexité de la pensée développée par les architectes».** Le missile envoyé dans le jardin du Moniteur, alors encore à son apogée, déclenchait une immense polémique. Le début de la réflexion.
«Nous avons commencé avec un groupe de gens qui se rencontraient par affinité», se souvient David Trottin. Lui-même avait déjà vécu une expérience similaire en 2003/2004 avec la bande des Michelin, Lyon, Perrault ou Gazeau. L’expérience, «sympathique au demeurant», avait tourné court. «On s’échauffait, on avait des idées mais rien n’était jamais concrétisé», se souvient-il. Pour leur part, les agences Philéas et Koz connaissaient déjà la dynamique de Plan 01. Des valeurs et des envies communes ont bientôt fait un collectif. «Le courant a très bien pris, chacun a appelé des copains», résume le fondateur, avec Anne-Françoise Jumeau, de Périphériques. En 2007, la French Touch compte seize agences parisiennes.

«Nous nous présentions les uns aux autres des projets, des concours, la bienveillance était de mise et la critique avait sa place», poursuit l’architecte. «Nous avons réalisé que nous faisions tous un grand nombre de projets que nul ne voyait jamais. Si ce constat s’imposait à notre échelle, qu’en était-il à l’échelle de la France ?», raconte Nicolas Ziesel. On n’est jamais mieux servi que par soi-même dit l’adage. En tout cas, pendant sept ans, La French Touch publie chaque année le pendant de l’annuel de d’’AMC, édité par le Moniteur, critiquant autant sa forme que son fond, du choix des lauréats à la mise en page de l’objet.
Pour Julien Zanassi (Philéas), derrière la French Touch, il y avait aussi la volonté d’acquérir une part du marché de la commande publique, qui, il y a dix ans était encore d’une certaine façon très lié au groupe Moniteur. «Il y avait une communication Le Moniteur et une façon de faire les appels d’offres en marchés publics. Aujourd’hui, il y a plein de Moniteur et huit procédures d’appels d’offres différentes», note-il.
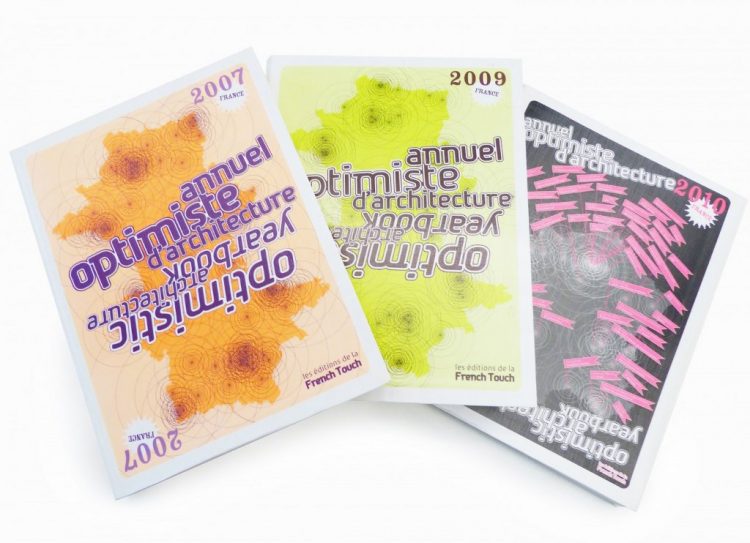
«Nous avons anticipé la communication de l’architecture qui a toujours été un sujet sensible car, de par sa nature, qui dit communication dit retombée des marchés. Le Moniteur proposait une hiérarchie, mettait en avant certains qui ensuite gagnaient les marchés», détaille David Trottin. Mais ça, c’était avant et en dix ans le système a explosé, la French Touch accompagnant cette évolution.
Le collectif voulait montrer que l’architecture française n’était pas que parisienne et que le talent n’était pas lié au budget ou à la taille des images montrées dans l’annuel de l’AMC. «En disant non, nous nous sommes faits connaître. Ce qui est amusant est que cela faisait quand même un moment que le petit monde de l’architecture n’avait pas connu un tel choc électrique», se souvient Gaëlle Hamonic. Ann-José Arlot, ancienne directrice de la DAPA (Direction de l’Architecture et du Patrimoine), leur a alors proposé le Pavillon français de Venise***. «Nous sommes passés de rebelles à laquais» en rient-ils aujourd’hui. Il n’empêche, à l’époque, les critiques ont fusé de toutes parts.

«Un certain nombre de gens nous détestaient», se souvient l’associé de Koz. Notamment parce que nombre de membres du collectif n’étaient pas des perdreaux de l’année mais des agences déjà bien installées, Périphériques avait même eu la Mention de l’Equerre d’Argent en 2006. Ils sont qualifiés, par Libération notamment, «d’habiles communicants». «Il nous était reproché de faire de l’autopromotion, qu’il n’y avait pas de fond à notre posture. En réalité la critique était facile parce que nous n’étions pas politiquement et théoriquement engagés», souligne Gaëlle Hamonic.
De fait, que la French Touch ne soit pas un courant théorique rend difficile à appréhender ce mouvement. Il s’agissait de «faire», en témoigne la fabrication de l’Annuel Optimiste, du choix des dessins de Franck Tallon à Diane Berg au grammage et à l’expédition. «Nous allions visiter tous les bâtiments, nous prenions les photos, nous redessinions les plans», rappelle Nicolas Ziesel. «Pour sortir le premier numéro, on s’est mis dans une charrette de six mois !», dit-il. Il fallait en avoir envie, en sus du travail habituel de l’agence.
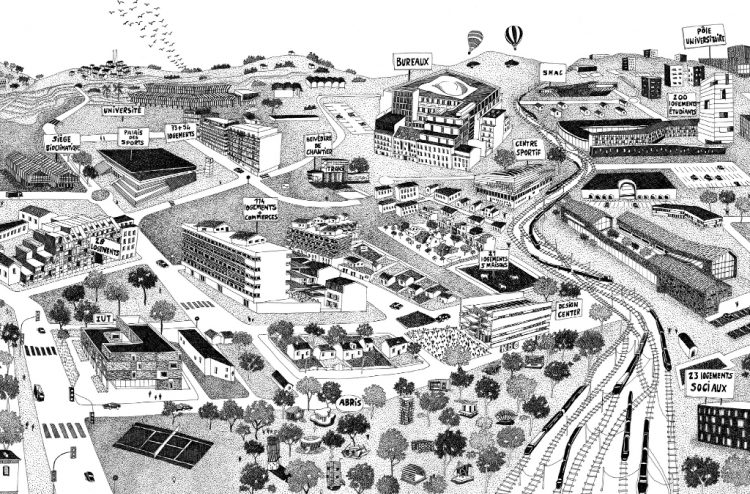
Dix ans plus tard, quel bilan ? «Nous avons manqué l’international», souligne Gaëlle Hamonic. «Les Français ne sont pas attendus là en architecture ! Quelle agence française peut vraiment rivaliser avec les Anglo-Saxonnes ?» ajoute Julien Zanassi. «Nous étions des OVNI», tempère Nicolas Ziesel.
Fondamentalement, la fin de l’expérience était-elle inéluctable ? «Un collectif d’architecte fonctionne quand il n’y a pas de stratégie, pas de prise de pouvoir», martèle Julien Zanassi. Comprenez, un collectif est voué à ne pas durer puisque, par définition, il n’est pas fait pour. «Sinon, nous serions devenus une agence».
Qui plus est, en dix ans, dans le domaine de l’architecture comme dans d’autres, le modèle économique global s’est transformé et le métier est en phase de mutation. L’architecte n’est plus le prestataire qui arrive en bout de chaîne mais doit être à la fois le concepteur, le promoteur, l’investisseur… «On devient des start-up», remarque David Trottin.
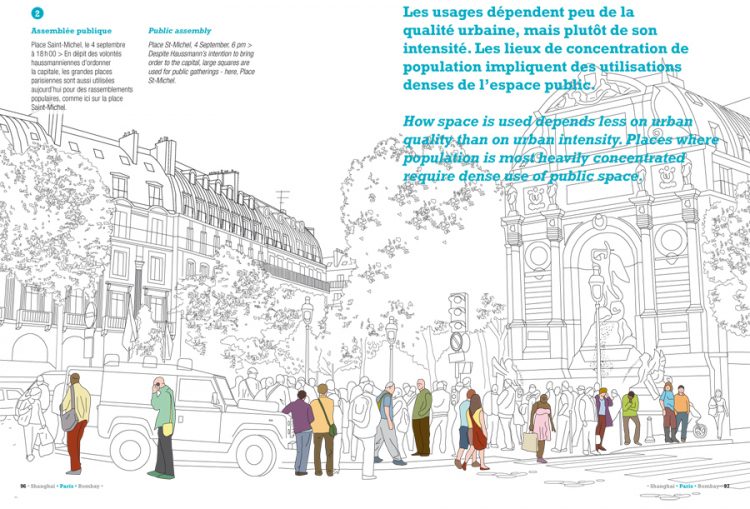
L’année 2007 était aussi une année d’élections présidentielles, ce qui amène à regarder l’évolution de la dimension politique de l’architecture. «Les grandes constructions, la grande fabrique de la ville ont pu voir le jour parce que la société avait un besoin. Cette réponse au besoin était guidée par l’Etat, qu’il soit Royauté, Empire ou République. Que défend-on aujourd’hui ? Qui sont nos veuves et opprimés en architecture ?», interroge Julien Zanassi.
Et David Trottin et Nicolas Ziesel de constater simultanément qu’ils sont également «orphelins d’une dimension critique de l’architecture». Beaucoup de gens ont voulu voir dans la French touch un modèle de pression sur les médias mais au moins il y eut débat. La multiplication des supports, Internet notamment, a changé la donne. «Aujourd’hui tout le monde peut dire n’importe quoi et personne ne répond», déplorent-ils. De fait, Jean Nouvel publie une tribune dans Le Monde et personne ne réagit. «Se souvenir que Réinventer Paris, ce n’est pas la réalité de l’architecture en France», conclut Julien Zanassi.

En 2007, il fallait être optimiste pour espérer infléchir un tant soit peu le système de la communication de l’architecture. En 2017 ?
Léa Muller
*Pour mémoire, les nominés de 2007, outre Nathalie Franck et Yves Ballot, étaient Jacques Ferrier pour la Cité de la voile à Lorient, Moati-et-Rivière pour le Musée Champollion de Figeac, Lipsky-Rollet pour le musée du Cristal, Ibos&Vitart pour les archives départementales de Rennes et Rudy Ricciotti pour le Pavillon noir d’Aix-en-Provence. Excusez du peu.
**Lire notre article A 100 ans et plus, Le Moniteur, une institution en question
*** Lire notre article Questions d’actualité avec la French Touch