
Vide : quel bien triste mot, dont la nature a horreur. Pourtant un mot plein de sens et d’intérêt, à de nombreux égards, pour le développement durable notamment. Dans les interstices, la vie à foison ? Chronique de l’intensité.
Le « vide » a souvent représenté ce qui ne compte pas, ce dont l’existence n’est même pas perçue. Les spécialistes d’un domaine considèrent souvent ainsi le reste du monde, comme une sorte de vide. Tout se passe comme si les projets qui entrent dans une autre logique que la sienne propre n’existent pas. La nature sauvage ou cultivée est parfois ramenée à des espaces résiduels ou des réserves foncières à équiper. Ironie de la méthode, d’aucuns sont ainsi parvenus ici et là à les protéger en les faisant passer pour des « équipements ».
Les solutions « passives » dans les bâtiments sont souvent déconsidérées car assimilées à l’absence de prise en compte du problème. Un immeuble de bureau non climatisé du fait de sa bonne conception architecturale et de ses matériaux est bien plus intelligent que son homologue de conception classique et climatisé : il rend un service continu, sans brutalité pour les organismes, il évite les températures extrêmes, il est économe en énergie, et il n’y a pas ce problème crucial de l’entretien des circuits d’air et des filtres.
Bon pour le confort, bon pour le porte-monnaie, bon pour la santé. Mais pas climatisé ! Pour qui nous prend-on ? Ce n’est pas moderne, nous méritons mieux ! Le non-équipement est toujours un peu dur à faire accepter car il ne se voit pas, tout comme l’énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Peut-être faut-il « mettre en scène » ces solutions dont la modestie devient un handicap. Le vide s’applique aussi pour les décisions.
Ne rien faire est parfois une bonne solution, parfois c’est la pire. Car ne rien faire est un choix, c’est laisser faire les évènements, c’est laisser perdurer une situation avec ses avantages et ses inconvénients, se laisser aller au fil de l’eau. Les études d’impact sur l’environnement devraient toujours s’interroger sur la solution zéro, ne rien faire, et la considérer comme une option à comparer aux projets envisagés. Il arrive que le vide, l’absence de décision, soit le plein de sagesse.
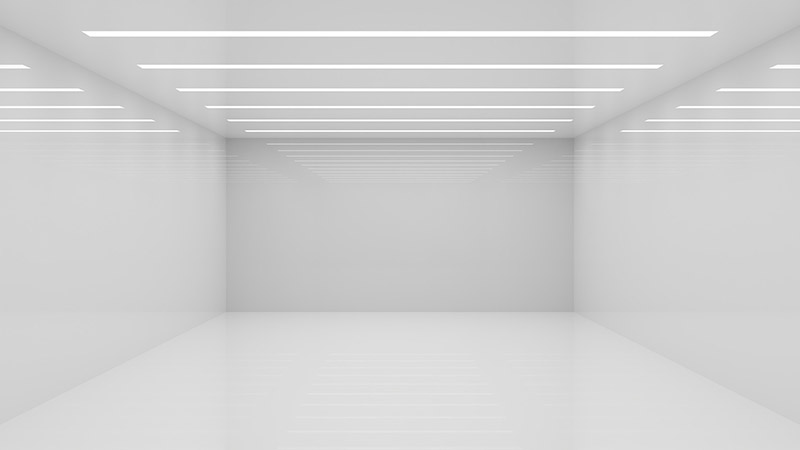
Revenons au vide classique avec cet exemple d’un professeur qui arrivait devant ses élèves avec un seau plein de gros cailloux. Est-il plein ? Bien sûr ! Il sortait alors un sac de graviers, qu’il versait dans le seau lequel, d’évidence, malgré les apparences était loin d’être plein.
Les interstices sont très importants. Interstices physiques, entre les cailloux, ou entre deux rangées de voitures, où se glissent des deux roues. Une même voirie qui trouve ainsi sa capacité de déplacements sensiblement accrue mais au prix de voir se réduire espaces de respiration et de sécurité. La cohabitation de véhicules différents permet un meilleur rendement de la voirie mais suppose que les utilisateurs compensent par leurs comportements le rétrécissement de l’espace offert à chacun.
Séparer les flux, les voitures d’un côté, les vélos de l’autre, par exemple, c’est se priver de toute possibilité de valoriser ces interstices, c’est perdre de l’espace public, si précieux en ville. Ce sont les difficultés de cohabitation qui rendent nécessaire cette séparation physique, qui ne fait que concrétiser et pérenniser l’incompréhension réciproque des tenants des différents modes de transport.
La séparation des flux ne se justifie que par le besoin d’accorder une priorité à certains modes de transports, comme l’autobus, mais ne peut être érigée en système. D’ailleurs, que faire des deux roues motorisés, qui ne sont ni voitures ni vélos, ou encore des « huit roues », les rollers, qui ne sont ni piéton ni vélo. Substituer la séparation matérielle à la recherche d’un respect mutuel ne peut n’être qu’un pis-aller. C’est une réduction de l’intensité de l’usage des espaces publics, qui en plus renforce le communautarisme de chaque catégorie d’usagers.
Les interstices sont aussi économiques. On parle alors de niches. Les entreprises d’insertion se glissent souvent dans ces vides, abandonnés des entreprises classiques, pour cause de non-rentabilité. La récupération de déchets de tous genres, des vêtements aux huiles usagées et à la ferraille, est souvent prise en charge par de telles structures, dont la tâche consiste à explorer les interstices de la société pour y déceler les petits gisements. Un double service est ainsi rendu, d’une part la récupération de matières en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage, et une opportunité pour des personnes en difficulté de retrouver un rôle dans la société, si modeste soit-il.
Encore faut-il laisser vivre ce type d’activité, forcément décalé par rapport aux usages courants. En 1999, la crise du poulet belge, nourri aux huiles de vidange, a ainsi été fatale à des sociétés d’insertion qui vivaient de la récupération d’huiles usagées dans les restaurants, activité tout à fait saine et écologique. Malgré leur intérêt bien réel, les activités des interstices sont perçues comme marginales. Ce sont les premières victimes dès qu’une crise se présente, ce qui ne fait d’ailleurs que renforcer cette dernière.
La France rurale de jadis avait parfaitement intégré cette logique du vide laissé par la fin de l’exploitation d’un champ après la moisson. Deux pratiques méritent d’être mentionnées : la vaine pâture, possibilité offerte à chaque propriétaire de bestiaux de les faire paître sur les chaumes des champs récemment moissonnés, permettait à la fois de nourrir les vaches et leurs propriétaires d’un côté, la terre de l’autre ; et puis la récolte des épis qui restent après la moisson, glanés par ceux qui n’ont pas de terre.
Le vide est ainsi rempli au profit de tous, les terres privées deviennent collectives le temps laissé libre entre les moissons et les labours. Bref, pour paraphraser une réplique célèbre, le vide est un plein qui s’ignore. C’est une ressource, diffuse mais très répandue, qu’il serait coupable d’ignorer dans un monde à la recherche de performances en tous genres.
Il faut juste laisser un espace à ceux qui vivent dans ces interstices, qui savent exploiter le vide et qui en vivent.
Dominique Bidou