
Ces derniers mois, PCA-STREAM fait l’actualité : un second MIPIM Award pour le 15 rue Laborde à Paris, la réhabilitation du 52 Champs-Élysées ou l’étude « Réenchanter les Champs-Élysées »… Devenu architecte sur le tard, Philippe Chiambaretta évoque une vision de l’architecture dont le principal moteur serait la recherche de l’intelligence collective. Rencontre.
Chroniques – Vous êtes devenu architecte à presque 40 ans. Pourquoi choisir cette profession si tardivement ?
Philippe Chiambaretta – Mon parcours est un peu original, puisque j’ai fait d’autres études et métiers avant de devenir architecte. Il s’agit donc d’un véritable choix, un choix d’ingénieur, pas celui d’un adolescent de 18 ou 20 ans. Après une formation scientifique, j’ai travaillé dans différents secteurs économiques, le conseil en stratégie par exemple, des choses sérieuses, un peu ennuyeuses aussi, mais qui m’ont beaucoup appris, notamment sur la production architecturale. En dehors des logiques de création, il y a celles liées à la production de valeurs et de richesse dans le monde de l’économie, qui sont souvent mal connues par les architectes. Les appréhendant mal, ils ne les aiment pas et les méprisent, d’où la revendication d’une position singulière de créateur.
J’ai hésité une première fois à faire ce métier quand j’étais aux Ponts-et-Chaussées mais, en voyant ce qu’était la formation à l’époque, j’ai renoncé. Puis j’ai eu l’occasion de travailler pendant dix ans avec Ricardo Bofill, pour qui j’étais responsable des activités internationales. J’y ai découvert l’intérêt du métier et c’est ce qui m’a amené tardivement à mener des études d’architecture.
Dans mes fonctions précédentes puis avec Bofill, j’avais pu observer l’évolution du contexte sociétal, le bouleversement de l’économie mondiale, l’évolution des rapports entre la culture, le pouvoir et l’économie. Tout était en train de changer. Quand j’ai créé l’agence en 2000, nous étions dans une époque de transition. Pour toutes ces raisons, j’ai assez rapidement abordé ce métier non pas simplement comme l’art de construire mais comme une activité privilégiée pour comprendre et agir sur les grands sujets d’une époque.

Cet acte de design – dans le sens anglo-saxon du terme – fusionne des données hétérogènes, prisonnières de leurs champs du savoir : l’économie, la technique, la création ou la politique. Ces différents domaines se côtoient, se frictionnent et se rencontrent. Cet échange prend forme dans le design et, en particulier, le design architectural. L’architecture résulte d’une logique de production, au sens production industrielle du terme, mais aussi comme production d’un événement, de manière autonome. Quand vous voyagez à Paris, New-York, Madrid, vous voyez qu’une réalité physique émerge de la société. C’est ce qui me fascine en architecture : au-delà du talent d’un designer ou d’un créateur, c’est une société qui parle.
Durant les vingt dernières années, la dématérialisation de l’économie s’est accélérée, ce que décrit Pierre Veltz* quand il parle de «société de l’immatériel». Dans nos échanges et dans nos quotidiens, une forme d’abstraction gagne, mais l’architecture demeure un ancrage matériel, elle est ce qui nous maintient en forme, pour faire un jeu de mots.
Comment définir Stream, votre projet de recherche ?
Comment, à côté de l’activité de bâtisseur, continuer à réfléchir et comprendre ce qui est en train de se passer ? En utilisant les différents champs du savoir : la philosophie, l’anthropologie, la sociologie, l’économie, etc. En appréhendant l’architecture par l’exploration de ses propres logiques de production, de la politique à l’économie, en passant par les sciences humaines.
L’objectif d’une démarche de recherche, avec la production d’une revue, c’est de comprendre ce qu’il y a derrière ce métier, de le prendre comme point d’entrée. Ayant fait de l’architecture tardivement, c’était une manière de m’oublier pour essayer de comprendre le monde.
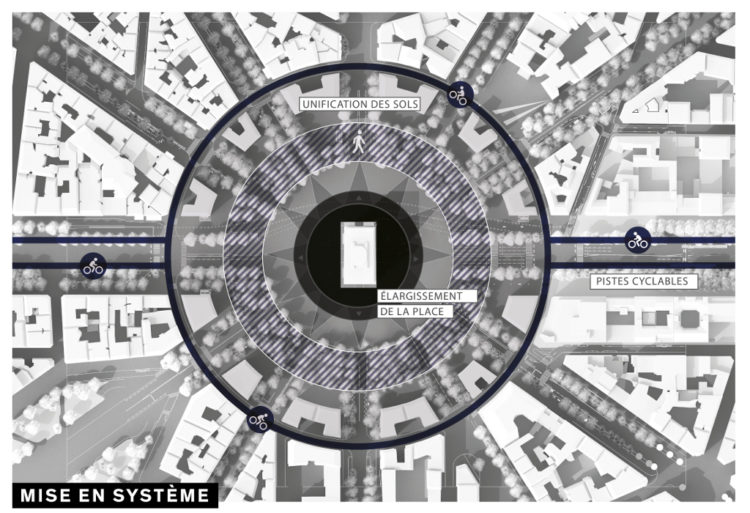
À une époque où les choses vont à une vitesse exponentielle, éditer une revue est une façon de faire perdurer une forme et de réunir un groupe de personnes qui ont des choses en commun. Peu à peu, un protocole s’est mis en place, qui consiste à s’emparer de sujets de société et les étudier par le biais d’une approche transdisciplinaire, de façon à aboutir à une conclusion transversale, systémique, complexe. C’était un peu intuitif au départ, puis j’ai compris qu’il s’agissait d’un acte déterminant et essentiel dans ma pratique. J’avais envie de discuter avec des philosophes, des anthropologues, des sociologues, etc.
La revue est intégralement financée par l’agence, au titre de la recherche et développement. Nous avons édité un premier ouvrage en 2008, Exploration, un deuxième en 2012, After office, un troisième, Habiter l’Anthropocène, en 2014, et en 2017, Les Paradoxes du vivant. Nous travaillons sur le prochain, prévu en 2020. C’est lent. Nous ne parlons pas des projets de l’agence, ce n’est pas de la promotion déguisée. C’est un travail rigoureux, mais qui n’est ni académique, ni politique.
Par exemple, le bureau était considéré comme un espace peu noble, commercial. C’est une erreur tant la frontière entre travail, amitié et loisirs est en train de s’estomper. On passe l’essentiel de notre vie au bureau et il faudrait lui accorder si peu d’importance ? J’avais l’intuition qu’il s’agissait d’un espace en pleine révolution. Nous avons lancé cette étude au moment de la crise des ‘‘subprimes’’ avec l’hypothèse qu’il y aurait un changement, un grand bouleversement qui naîtrait après la crise…

Quand nous avons commencé, WeWork n’existait pas, alors que le coworking est aujourd’hui monnaie courante. La question d’After Office était de se demander si le bureau allait disparaître : a-t-on encore besoin de se rendre au travail pour produire alors que nous avons tous un smartphone ? La conclusion a été l’inverse. La dématérialisation implique de se réunir encore plus, car nous sommes entrés dans un monde où c’est la qualité des rapports entre des gens, la production d’une intelligence collective qui devient la clé de la réussite.
Cette question de l’After Office, nous avons eu la chance de pouvoir rapidement l’appliquer sur un projet, le #cloud.paris, dont le chantier débutait en 2011, au moment où sortait le livre. La SFL (Société Foncière Lyonnaise) avait un problème avec ses 38 000 m² obsolètes au cœur de Paris : tout était à refaire, et les investisseurs se demandaient qui allait pouvoir venir, quel était le modèle économique, etc. J’ai proposé ma vision, elle a fonctionné. Résultat, Facebook a choisi #cloud.paris comme siège, et BlaBlaCar, qui n’existait pas quand on a commencé à concevoir le bâtiment, s’y est également installé. Suite à ce projet nous avons été de plus en plus sollicités pour notre expertise en tertiaire innovant… C’est un des mauvais réflexes de la profession, les cases… Il faut vite s’échapper et ouvrir une nouvelle voie pour ne pas se laisser enfermer.
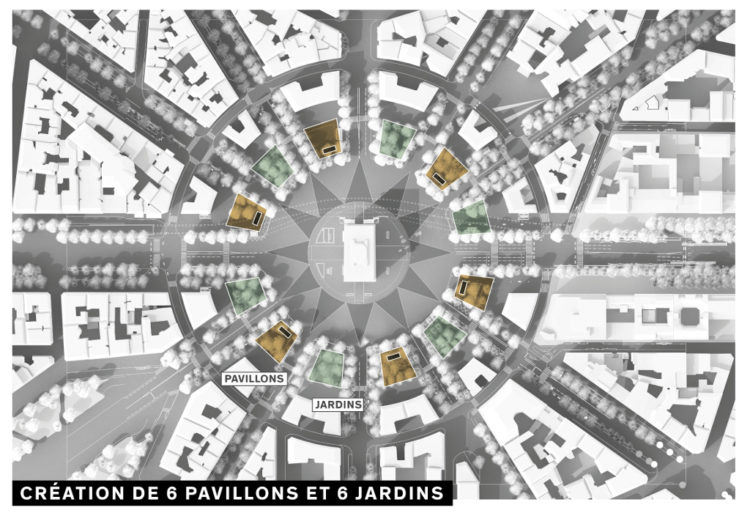
Cette approche prospective a-t-elle modifié votre façon de faire des projets ?
L’architecture doit participer d’un véritable projet, ne pas être un produit standard pour des financiers. Il nous faut proposer un scénario d’existence. Lors d’un concours classique, le système est normé : il y a un programme, chacun fait son image et rend sa copie, sans dialogue. Les architectes sont contents, ils vont faire une œuvre, mais cette méthode produit énormément d’éléphants blancs, d’objets iconiques qui pour moi relèvent du fantasme solitaire…
Nous prenons volontairement le contre-pied de cette vision de l’architecte-auteur : à la création à sens unique, nous préférons l’échange. Le dialogue ne veut pas dire soumission, il signifie argumentation, conviction, c’est une position de force. Il faut justement avoir une vision, arriver avec une histoire à raconter. Pour renverser le rapport de force, nous devons défendre des valeurs, une vision. L’architecture est un acte politique, nous ne sommes pas des prestataires de services. Je veux faire de l’architecture comme un engagement.
La recherche permet de construire des convictions. C’est le renversement de posture que je défends pour bâtir une vision singulière qui ne soit pas une question de style mais de compréhension, d’analyse, de méthodologie, qui passe par l’idée de transdisciplinarité. L’architecture a toujours été transdisciplinaire, mais elle relève chaque jour davantage de l’intelligence collective, de la pensée collective, avec des modes de projets différents, avec des gens qui n’étaient pas invités avant (plasticiens, historiens, géographes, etc.), un peu comme je le fais dans la revue.
Propos recueillis par Julie Roland
*Pierre Veltz est ingénieur des Ponts et Chaussées et docteur en sociologie, ancien directeur de l’ENPC et de l’Ihédate. Il a enseigné à l’École des Ponts et à Sciences Po.